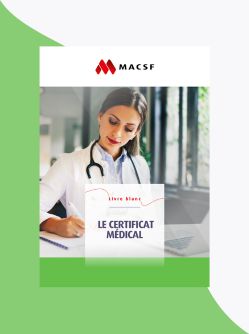Pour commencer, testez vos connaissances
Saisissez le pseudo de votre choix (aucune donnée personnelle nécessaire)
Qu’entend-on par inaptitude à la conduite automobile ?
Les pathologies susceptibles d’avoir un effet sur l’aptitude à la conduite sont diverses. Selon leur degré de gravité et la manière dont elles sont prises en charge, leurs conséquences sont plus ou moins gênantes et elles ne sont pas systématiquement à l’origine d’une inaptitude.
On parle ainsi, selon les cas, d’incompatibilité temporaire ou définitive avec la conduite.
Voici les principales pathologies concernées :
- Pathologies ophtalmiques (troubles de la vision entraînant une diminution plus ou moins importante de l’acuité visuelle, nystagmus, diplopie, altération de la vision nocturne, etc.)
- Pathologies ORL (surdité, troubles de l’équilibre, etc.)
- Pathologies ou lésions du système nerveux, à l’origine de troubles cognitifs, moteurs ou sensoriels
- Troubles cognitifs dont la maladie d’Alzheimer, selon son degré
- Addictions à l’alcool, à la drogue ou aux médicaments
- Epilepsie
- Somnolence excessive non traitée
- Pathologies cardiovasculaires avec risque de malaise au volant
- Diabète avec risque de malaise
- Insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire
- Insuffisance rénale selon son stade
Certains de ces déficits ou de ces pathologies, auparavant considérés comme incompatibles avec la conduite, peuvent aujourd’hui être compensés par des aménagements du véhicule. C’est pour tenir compte des innovations scientifiques et technologiques ouvrant l'accès à la conduite que l’arrêté du 21 décembre 2005* a été remplacé par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022.
*fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
Existe-t-il un contrôle systématique de l’aptitude à la conduite ?
Les titulaires des permis dits "lourd", c’est-à-dire à usage professionnel (poids lourds, transports en commun), sont soumis à un contrôle médical :
- systématique avant passage du permis,
- et de manière périodique ensuite.
Pour les titulaires des permis dits "léger" (A1, A2, A, B, B1 et BE), il n’y a aucun caractère obligatoire et tout repose sur la seule volonté du titulaire. Comme le rappelle l’arrêté dans son article 1er, c’est au conducteur qu’il revient d’apprécier sa capacité à conduire au regard de ses affections médicales, de son état de fatigue et de vigilance, de sa capacité de mobilité, de la prise de médicaments ou de substances psychoactives.
Avant de passer le permis
Le candidat qui se sait atteint de l'une des affections médicales mentionnées à l'annexe de l’arrêté du 28 mars 2022 doit la déclarer spontanément lors de son inscription par la télé-procédure "demande de permis de conduire". S’il ne l’a pas fait, et s’il est constaté une éventuelle incompatibilité avec la conduite lors des épreuves pratiques du permis, le préfet peut être sollicité pour imposer un contrôle médical par un médecin agréé.
Une fois le permis léger obtenu
Une évaluation périodique obligatoire de l’aptitude à conduire n’est prévue que dans certains cas particuliers : après certaines infractions routières (suspension de plus d’un mois ou annulation du permis de conduire), après un accident corporel grave ou, en dehors de ces hypothèses, en cas d’usage du permis pour l’exercice de certaines professions : moniteurs d’auto-école, conducteurs de taxi, VTC, ambulance, ramassage scolaire, etc.
Dans les faits, c’est donc souvent à l’occasion d’une consultation de routine qu’un médecin peut être amené à constater une inaptitude à la conduite, temporaire ou définitive, de l’un de ses patients. Se pose alors la question des mesures à prendre à son égard.
Le médecin peut-il interdire à son patient de conduire ?
Quand il constate un état pathologique susceptible d’interférer avec la conduite, le médecin ne peut évidemment :
- imposer l’arrêt de la conduite à son patient, puisqu’il ne dispose à son égard d’aucun pouvoir de coercition ;
- opérer un signalement auprès des autorités compétentes puisque cette hypothèse de violation du secret médical n’est pas prévue par la loi.
L’arrêté ministériel du 28 mars 2022 fait peser sur le seul patient la responsabilité de déclarer sa situation et de se soumettre à un examen par un médecin agréé.
Pour autant, le médecin traitant ne peut rester inactif. Il doit agir, au titre des obligations générales d’information qui pèsent sur lui.
—
Le médecin doit-il alerter le patient ?
Le praticien a une obligation générale d’information sur la pathologie et les traitements prescrits, ainsi que sur leurs effets secondaires et leurs conséquences. Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel ; elle doit être claire, loyale, appropriée et compréhensible. La preuve peut en être apportée par tout moyen.
Lors du diagnostic d’une pathologie ou de la prescription d’un traitement affectant la vigilance au volant, le praticien doit informer son patient des possibles incidences sur la conduite automobile.
Si les textes relatifs à l’information donnent la priorité à l’oral en évoquant un entretien individuel, il est toutefois vivement conseillé de porter une mention écrite au dossier du patient afin de se prémunir en cas de plainte ultérieure.
Le praticien doit attirer l’attention de son patient (ou celle de son entourage lorsqu’il s’agit d’une pathologie abolissant le discernement) sur le fait que la maladie ou la prise médicamenteuse peut rendre plus dangereuse la conduite automobile ou, du moins, nécessiter quelques précautions supplémentaires :
- vigilance vis-à-vis des signes annonciateurs,
- pauses en cas de longue distance,
- éviter les périodes de circulation difficile,
- optimiser la prise médicamenteuse pour une meilleure conciliation avec les périodes de conduite dans la journée,
- la vitesse,
- l’alcool,
- la conduite après un repas, etc.
Enfin, le médecin doit inviter le patient à prendre rendez-vous avec un médecin agréé, en lui en fournissant la liste ou en l’invitant à la consulter sur le site Internet de la préfecture.
Dans son rapport « Prévention et sécurité routière : quelle place pour le médecin ? État des lieux et propositions d’actions » adopté en juin 2024, le CNOM ajoute quelques éléments importants.
Il précise notamment qu’à chaque entretien, il est conseillé de réinterroger le patient afin de savoir s’il a pris rendez-vous avec un médecin agréé et de le noter dans le dossier médical.
Que faire quand le patient, pourtant informé des risques, persiste à conduire ?
Le médecin ne peut pas directement contacter la préfecture car, ce faisant, il ne respecterait pas le secret médical. Aucun texte ne l’y autorise. Au contraire, l’arrêté du 28 mars 2022 a bien confirmé que la déclaration d’un état pathologique affectant la conduite est du seul ressort du titulaire du permis léger.
Aussi, lorsqu’il semble au médecin que les risques sont vraiment élevés et qu’une information n’est pas suffisante (par exemple dans certains cas de maladies mentales), il peut conseiller à la famille ou aux proches d’alerter le Préfet, seul habilité à ordonner un examen médical d’aptitude.
Le médecin engage-t-il sa responsabilité en cas d’accident ?
Une mise en cause de la responsabilité du médecin traitant en cas d’accident automobile provoqué par un patient inapte à la conduite est peu probable, mais elle est théoriquement possible.
Sur le plan civil
La responsabilité du praticien pourrait se trouver engagée s’il était établi qu’il n’a pas rempli son devoir d’information et n’a formulé auprès de son patient aucune mise en garde alors que, du fait de la maladie ou des médicaments absorbés, il savait la conduite automobile risquée.
Sur le plan pénal
La responsabilité du médecin pourrait être envisagée à deux titres :
- Mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal)
Cela concerne les situations exposant directement une personne à un risque immédiat d’une extrême gravité, en violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, et de manière manifestement délibérée : encore faut-il qu’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par les textes ait été violée.
Cette violation sera difficile à établir, s’agissant du médecin, puisqu’il n’existe pas à l’heure actuelle de dispositions législatives ou réglementaires lui permettant d’empêcher son patient de conduire de façon coercitive.
- Homicide ou blessures involontaires (article 121-3 alinéa 3 du code pénal)
Dans ce cas, l’auteur indirect d’un dommage (c'est-à-dire celui qui a contribué à créer la situation dommageable ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter) est sanctionné.
Cependant, il faut qu’il soit relevé, soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.
Cette violation délibérée sera difficile à établir à l’égard du médecin puisqu’il n’existe aucune disposition réglementaire ou légale l’obligeant à agir à l’égard de son patient, autrement qu’en l’informant.
Quelles précautions prendre en cas de prescription de médicaments affectant la vigilance au volant ?
Il existe trois catégories de médicaments présentant un risque pour la conduite automobile, signalé sur les boîtes par des pictogrammes :
- Risque faible, qui varie en fonction des personnes.
- Risque d’effets secondaires sur la conduite.
- Conduite dangereuse, avec la mention "ne pas conduire".
Quand il prescrit ce type de médicament, le médecin doit impérativement attirer l’attention de son patient sur les risques à conduire et l’inviter à ne pas prendre le volant, là encore sans pouvoir l’y contraindre.
La Sécurité routière a lancé en 2022 une grande campagne d’information intitulée "Docteur, est-ce que c’est grave si je conduis ?".
Dans ce cadre, elle a mis une brochure à disposition des professionnels de santé qui regroupe, sous forme synthétique, les principaux éléments pour informer les patients que leur état de santé est susceptible d’interférer avec la conduite d’un véhicule léger.
Les soignants, acteurs de la prévention routière
En 2024, la MACSF a mené, en partenariat avec l’association Prévention Routière et son Conseil Médical, une étude sur le rôle des professionnels de santé auprès de leurs patients en matière de sensibilisation à la prévention routière.