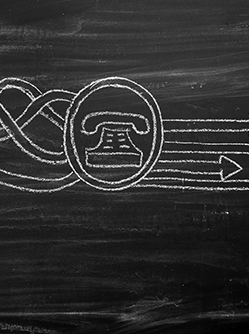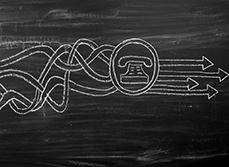Quels sont les grands principes en droit des contrats ?
L'article 1103 du code civil énonce que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont des documents contractuels qui encadrent et précisent les relations commerciales entre les parties.
Elles s’imposent donc entre le prestataire et son cocontractant qui les a signées, et de ce fait acceptées lors de la conclusion du contrat.
Cependant, que se passe-t-il lorsque ces conditions générales ne respectent pas la loi ?
La clause qui créé le déséquilibre significatif dans les relations entre les parties est réputée non écrite par le juge, comme le prévoit l’article L. 241-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives. Seule la clause "litigieuse" est concernée et pas le contrat dans son entier.
Néanmoins, tout le monde ne connaît pas forcément les textes applicables de sorte qu’un consommateur, par nature profane, pourrait se résoudre à prendre en compte et appliquer les CGV, même si leur contenu peut sembler quelque peu abusif.
D’où l’intérêt de mettre en lumière les divers arrêts rendus par les Tribunaux qui apportent des précisions sur ce qui est illégal ou non.
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation est un bon prétexte pour nous éclairer sur ce qui peut être de nature à évincer des clauses de CGV car illégales.
Les apports de l’arrêt de la Cour de Cassation
Cette affaire, finalement assez classique, concernait des dysfonctionnements de ligne téléphonique et internet – défaillances récurrentes de réseau – qui perturbaient l’activité d’une association. Deux clauses ont été contestées.
La clause soumettant l’opérateur à une simple obligation de moyens
Cette clause soumettait l’opérateur à une simple obligation de moyens en précisant que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour "faute prouvée".
La Cour de Cassation rappelle qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit à son client,
- soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
- soit à un cas de force majeure.
La Cour de Cassation rappelle donc que les opérateurs sont soumis à une obligation de résultat, c’est-à-dire que le cocontractant à l’obligation d’atteindre un résultat déterminé, et ne peut se contenter d’avoir mis en œuvre tous les moyens en sa possession.
La clause limitant dans le temps le recours du client
La deuxième clause, pour sa part, précisait qu’aucune action judiciaire ou réclamation ne pouvait être engagée contre l’opérateur plus d’un an après la survenance du fait générateur.
L’illégalité est également reconnue. En effet, le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle est de 5 ans à compter de la connaissance du dommage (article 2224 du code civil). Il est possible de réduire ce délai conventionnellement (article 2254 alinéa 1er du code civil), mais pas à moins d’une année à compter du jour où le cocontractant a connu ou aurait dû connaître les faits.
Ainsi, la clause réduisant le délai de recours à une simple année, non pas à compter de la connaissance des faits, mais à compter de la survenance du fait générateur (donc le dysfonctionnement et non la connaissance de ce dysfonctionnement), elle est considérée comme abusive.
Ainsi, la clause réduisant le délai de recours à une simple année, non pas à compter de la connaissance des faits, mais à compter de la survenance du fait générateur (donc le dysfonctionnement et non la connaissance de ce dysfonctionnement), elle est considérée comme abusive.
.png) À noter : dans cette affaire, le cocontractant était une association.
À noter : dans cette affaire, le cocontractant était une association.
Pour un consommateur, l’exclusion de la clause aurait été différente dans la mesure où l’article L. 218-1 du code de la consommation interdit les clauses raccourcissant la prescription dans les contrats entre professionnels et consommateurs.
À retenir
Il ressort donc de cet arrêt qu’un opérateur de télécommunication :
- engage sa responsabilité pour les dysfonctionnements du service, sauf s’il démontre que la cause du dysfonctionnement ne lui est pas imputable car elle résulte soit du client, soit d’un tiers, soit d’un cas de force majeure,
- ne peut pas faire courir la prescription à compter du dysfonctionnement.
Cet arrêt illustre donc bien les abus des contrats - ici de télécommunication - et l’interprétation stricte faite par les juges qui n’hésitent pas à sanctionner les opérateurs en écartant les clauses abusives de leurs contrats.
Les consommateurs doivent donc être particulièrement vigilants sur ce point et ne pas hésiter à rappeler aux opérateurs leurs obligations et à exiger la fourniture du service objet du contrat, en l’espèce la fourniture du service de téléphonie et internet.
—
Pour aller plus loin : d’autres exemples de clauses abusives
Le code de la consommation contient deux listes de clauses abusives :
- les clauses dites noires, c’est-à-dire complétement interdites, qui figurent à l’article R. 212-1 du code de la consommation,
- les clauses dites grises, pour lesquelles le professionnel peut démontrer qu’elles ne sont pas abusives, qui figurent à l’article R. 212-2 du code de la consommation.
Est ainsi une clause interdite :
- celle qui reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au consommateur.
- ou encore celle qui permet au professionnel de retenir les sommes versées pour des prestations qui ne sont pas réalisées, lorsqu'il résilie discrétionnairement le contrat.