Volontaire, automatique ou judiciaire : zoom sur les 3 types de dissolution d’un cabinet de groupe
Plusieurs situations peuvent aboutir à la fin d’une société, qu’elle soit ou non intentionnelle. En France, on dénombre à ce jour trois types de dissolution, correspondant à des cas de figure et des motifs différents.
Cas de figure n°1 : la dissolution volontaire
La cessation volontaire d’activité est le scénario le plus courant. Il concerne les entreprises qui ne sont pas en situation de cessation de paiement, et dont la dissolution n’est donc pas due à des difficultés financières ou des raisons légales.
On parle de « cessation volontaire », car une telle dissolution résulte de la volonté commune des associés de mettre fin à leur structure. Ce cas de figure se présente notamment lorsque :
- L’un des associés se retire (départ, retraite, décès, etc.) ;
- L’entente n’est plus au rendez-vous, mais l’équipe souhaite néanmoins se séparer « à l’amiable » ;
- Les associés anticipent une baisse d’activité pour des raisons économiques, démographiques ou stratégiques et préfèrent la devancer avant de se retrouver en difficulté.
La répartition post-dissolution : à insérer dans les statuts
Prévoir ce scénario dans les statuts de votre société permet de simplifier et de fluidifier les démarches liées à une future dissolution volontaire. Pour ce faire, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel du droit afin de formuler contractuellement la façon dont seront répartis les actifs et les passifs entre associés.
Cas de figure n°2 : la dissolution automatique
On parle de « dissolution automatique », mais également de « dissolution de plein droit » lorsque surviennent certains événements prévus par les statuts. Une telle dissolution peut intervenir dans quatre situations :
- La société arrive à son terme, c’est-à-dire qu’elle atteint la durée de vie fixée dans ses statuts, laquelle est au maximum de 99 ans ;
- La réalisation de l’objet social de la société, ce qui veut dire que l’opération pour laquelle elle avait été constituée est achevée de manière définitive ;
- L’extinction de l’objet social de la société, ce qui veut dire que l’activité pour laquelle elle avait été constituée n’est désormais plus possible ;
- La réalisation d’une cause prévue dans les statuts, comme le décès d’un associé.
Proroger la dissolution automatique
Pour éviter la dissolution automatique d’un cabinet de groupe arrivé à son terme, ses associés ont la possibilité de proroger cette durée. Ils doivent le faire au moins un an avant l’arrivée du terme, dans le cadre d’une assemblée des associés et à la majorité de ceux-là. Cette prolongation entraînant une modification des statuts, elle devra faire l’objet d’une publication dans un support d’annonces légales et d’un enregistrement au greffe du tribunal.
Cas de figure n°3 : la dissolution judiciaire
Dissoudre la société relève parfois de la décision d’un juge. On parle alors de dissolution judiciaire, également appelée « dissolution forcée ».
Cette dissolution forcée est prononcée dans l’une des quatre situations suivantes :
- Une dissolution pour « justes motifs » à la demande d’un associé, quand le fonctionnement de la société est paralysé en raison d’une mésentente qui rend impossible l’adoption de décisions collectives ;
- Une dissolution de société anonyme (SA), de société en nom collectif (SNC) ou de société civile de type société civile immobilière (SCI) en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main (la société doit alors être dissoute, car elle n’a plus les 2 associés minimum légalement requis, à moins que l’associé désormais unique ne régularise la situation dans un délai d’un an, par exemple en vendant des parts sociales à un nouvel associé) ;
- Une dissolution en cas de jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, quand le redressement judiciaire d’une société en difficultés financières n’est pas possible ;
- Une dissolution consécutive à une sanction pénale, dans le cas où la juridiction sanctionne une société condamnée pour des infractions (escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, etc.) en prononçant sa dissolution.
Quel que soit son motif, la dissolution judiciaire est décidée par le tribunal de commerce.
La seule exception concerne les sociétés civiles, pour lesquelles c’est le tribunal judiciaire qui est saisi. Le ministère de la Justice propose un annuaire qui répertorie les juridictions compétentes en fonction de la domiciliation de la société.
De la décision au constat de clôture, la dissolution d’un cabinet de groupe en 4 étapes
Que la décision de dissolution d’une société soit prise par ses associés ou par un juge, le processus est le même, et consiste en 4 étapes clés.
Étape n°1 : la désignation d’un liquidateur
Le liquidateur est chargé de mener à bien la dissolution de la société, mais également de rendre compte de sa gestion auprès des associés de cette dernière.
Sa nomination dépend du type de dissolution. Il peut s’agir d’un liquidateur amiable, nommé par les associés eux-mêmes, ou d’un liquidateur judiciaire nommé directement par le tribunal.
Dans le mois qui suit la décision de dissolution du cabinet de groupe, son liquidateur doit la déclarer auprès du guichet unique des formalités des entreprises en fournissant un certain nombre de documents (procès-verbal d’assemblée décidant de la dissolution, copie de la pièce d’identité du liquidateur, etc.).
Une fois la dissolution décidée, la société est considérée comme étant en liquidation.
Étape n°2 : les opérations de liquidation
Le liquidateur se charge notamment de :
- Réaliser l’actif de la société et vendre les biens qui lui appartiennent ;
- Apurer le passif, c’est-à-dire payer les dettes de la société et régler ses créanciers.
Concrètement, les comptes de liquidation sont des comptes classiques avec bilan et compte de résultat, mais qui seront les derniers établis pour la société dissoute.
Ils se soldent par la constatation d’un « boni de liquidation » en cas d’excédent financier à l’issue de la liquidation, ou d’un « mali de liquidation » en cas de résultat négatif des comptes de liquidation.
Reste alors au liquidateur à répartir le solde ou la dette éventuels entre les associés, en fonction de l’apport de chacun et conformément à ce que prévoient les statuts de la société.
Étape n°3 : le constat de clôture
Les opérations de liquidation achevées, ses associés sont alors convoqués en assemblée générale pour :
- Se prononcer sur les comptes définitifs de la société ;
- Décharger le liquidateur de son mandat (on parle de « quitus ») ;
clôturer la liquidation.
Cette ultime étape marque la disparition de la société et, avec elle, la possibilité pour chaque associé de retrouver son droit d’exercer à titre individuel.
Au terme de sa mission, le liquidateur est tenu de publier un avis de clôture de liquidation auprès d’un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département concerné, et ce dans un délai d’un mois.
Étape n°4 : la radiation de la société
Un mois au plus tard après la publication de la clôture de liquidation, un dossier de radiation doit être déposé auprès du guichet des formalités des entreprises. Il devra comporter :
- La décision de l’AG qui statue sur les comptes définitifs de liquidation de la société ;
- L’acte qui constate la clôture des opérations, certifié conforme par le liquidateur ;
- L’attestation de publication de l’avis de clôture dans un support habilité.
Il est essentiel de faire figurer dans les statuts et le pacte d’associés éventuellement conclu, dès la création de la société, l’ensemble des règles utiles pour accompagner les petits et les grands changements qui rythment la vie d’un cabinet de groupe. Le recours à un juriste est grandement conseillé, de manière à envisager tous les cas de figure et ainsi mieux anticiper les différents scénarios susceptibles de survenir.
Vous prévoyez d’exercer en groupe, mais vous avez besoin de conseils pour vous lancer ?
Cabinet de groupe, MSP, centre de santé… Quelle que soit la structure d’exercice en groupe envisagée, les experts de la MACSF vous accompagnent dans le diagnostic de votre projet et vous orientent vers les offres d’assurance, d’épargne et de prévoyance les mieux adaptées à vos objectifs, vos attentes et votre situation. Que vous soyez ou non sociétaire MACSF, prenez rendez-vous en quelques clics pour un check-up pro !



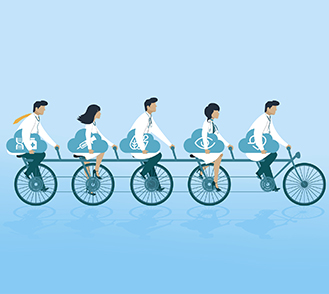
.png)




.png)







