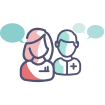Quelles sont les professions concernées ?
Les professions médicales et paramédicales suivantes sont constituées en Ordre professionnel :
- médecin,
- chirurgien-dentiste,
- sage-femme,
- pharmacien et laboratoire d’analyses,
- infirmière,
- masseur-kinésithérapeute,
- pédicure podologue.
Il entre notamment dans les missions de l’Ordre de veiller aux règles de confraternité et aux règles qui s’imposent à la profession vis-à-vis des tiers.
C’est un principe général que l’on retrouve dans ces différentes professions et qui est illustré dans les différents codes de déontologie.
Dans quelles conditions l’Ordre est-il saisi ?
L’Ordre peut se saisir lui-même ou peut être saisi par toute autre personne qui y a un intérêt pour contester une attitude ou des actes réalisés par un professionnel et qu’il considère non conformes à la déontologie.
Le pouvoir de saisine est très large et il n’y a pas que les patients ou les confrères qui peuvent saisir l’Ordre.
Les plaintes et doléances peuvent émaner des institutions (Ordre National, ARS, Caisses de Sécurité Sociale, Procureur de la République, etc…) comme de particuliers, d'entreprises privées, d'associations ou d'administrations.
La pratique peut être différente d’un conseil départemental à l’autre mais en règle générale, les courriers qui ne font pas référence expressément à une plainte sont considérés comme de simples "doléances".
Pourtant, dès ce stade, la qualification est importante :
- La simple doléance peut être classée sans suite par le Conseil de l’Ordre qui estimerait qu’elle est manifestement sans fondement ou sans crédibilité.
- La plainte qualifiée comme telle, même farfelue, donnera lieu, par contre, obligatoirement à une réunion de conciliation.
Sous quelle forme la convocation à une conciliation intervient-elle ?
Attention, les modalités peuvent être différentes :
A l’initiative de l’Ordre
La convocation en conciliation peut intervenir à l’initiative de l’Ordre en dehors de toute plainte : on parle alors souvent de convocation ou d’invitation confraternelle.
Cela répond au pouvoir général de régulation du conseil départemental. Dans ce cas, le praticien en cause ou les parties sont invitées à se présenter :
- d’une part pour que le conseil départemental puisse comprendre la réalité de la situation,
- et d’autre part, pour tenter une médiation, afin d’apaiser le conflit éventuel et de le clore.
Le plus souvent, les parties viennent seules mais elles peuvent être assistées d’un avocat dans le cadre des Droits de la défense, même s’il ne s’agit pas d’une action contentieuse, ni à ce stade d’une poursuite disciplinaire.
Dans ce cas de figure, les parties se rencontrent à l’Ordre et échangent librement pour trouver un terrain d’entente.
Un procès-verbal peut être rédigé mais s’il n’y a pas de conciliation, il n’y aura pas, a priori, de suite sauf si le Conseil départemental décide lui-même, de son propre chef de saisir la Chambre disciplinaire quand il considère que les faits sont graves.
En cas de plainte
Le conseil départemental a l’obligation, dans ce cas, d’organiser une conciliation et chaque partie peut être assistée.
Il y a obligatoirement rédaction d’un procès-verbal, qu’un accord soit trouvé ou non. Une conciliation partielle peut être constatée si une partie seulement du litige a été tranchée.
Traditionnellement, les plaintes et doléances sont ensuite examinées par le conseil départemental suivant, en séance plénière.
Même en cas de simple doléance, le conseil départemental peut décider de saisir la chambre disciplinaire de première instance de son propre chef.
En cas de conciliation sur une plainte, le conseil départemental n’est pas lié et peut, néanmoins, lui-même décider de saisir la chambre disciplinaire malgré tout.
Si les parties ne se sont pas conciliées et que la plainte est maintenue, elle est automatiquement examinée par le conseil départemental en séance plénière. Il sera contraint de la transmettre ensuite à la chambre disciplinaire.
Le conseil départemental doit transmettre la plainte avec un avis motivé et s’il estime que les faits sont suffisamment graves, il peut s’associer à la plainte.
C’est à l’issue de ce processus que la chambre disciplinaire sera réellement saisie et que les protagonistes devront argumenter sur la ou les fautes, voire l’absence de faute, au regard du code de déontologie.
Il arrive que le plaignant ne se présente finalement pas à la conciliation : dans ce cas un PV de carence est régularisé mais cela n’arrête pas la procédure disciplinaire…
Le conseil départemental est alors obligé de transmettre quand même la plainte à la chambre disciplinaire.
La phase de conciliation est, en principe, confidentielle, précisément pour que les parties soient libres de parler en présence du ou des conciliateurs et le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation doit être le plus succinct et le plus neutre possible.
Un engagement de confidentialité peut, éventuellement, être signé à la demande de l’Ordre.
A retenir
Avec un peu de bonne volonté, de nombreux litiges peuvent être solutionnés en conciliation : certificats médicaux mal rédigés, rétrocessions impayées, mauvaises interprétations de l’attitude du praticien, etc…
La réunion de conciliation est donc un moment très important qu’il faut préparer.
Il faut connaitre très exactement les griefs et demander à avoir copie des termes de la plainte ou de la doléance.
Il ne faudra pas oublier qu’il s’agit d’un moment destiné à recréer du lien : le cas échéant, reconnaître ses erreurs et offrir de les corriger et dans tous les cas, être à l’écoute ou ouvert au dialogue.
La parole ne doit pas être confisquée par le ou les avocats qui risqueraient de donner une tournure trop contentieuse à ce qui doit être, au contraire, un moment d’apaisement.