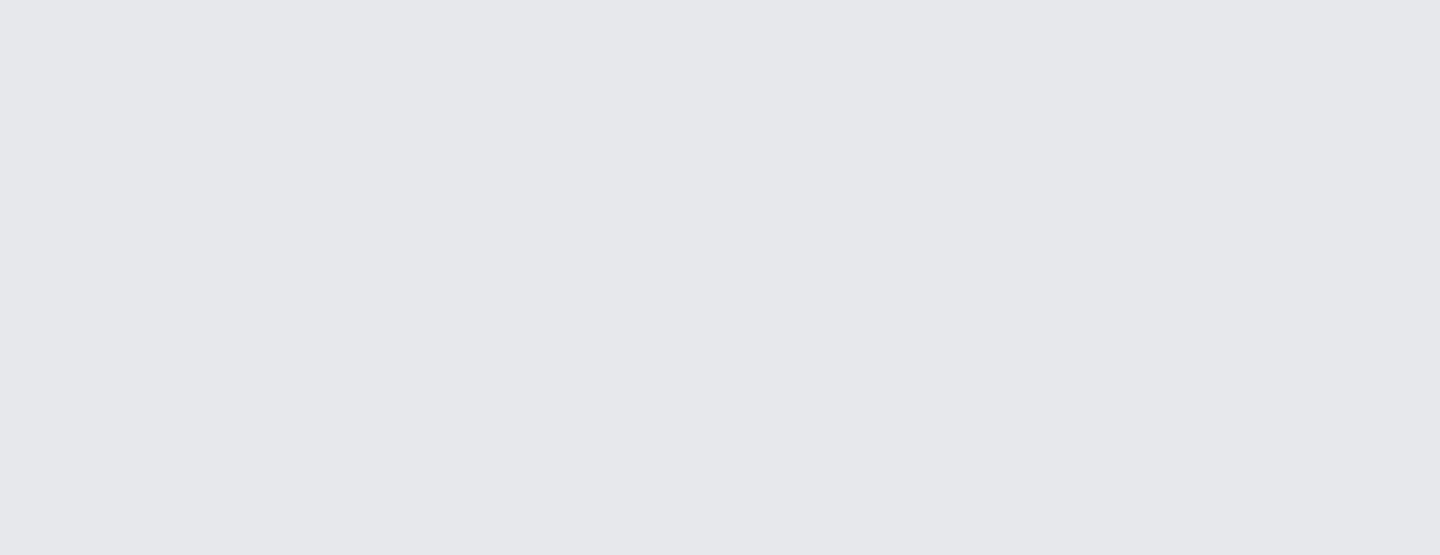Répartition des réclamations
Les animaux de compagnie représentent une part importante puisque 56 % des plaintes et réclamations enregistrées en 2023 les concernent. Il s’agit essentiellement de chiens et de chats puisque cette année encore un seul litige a visé la prise en charge d’un NAC.
Une légère baisse a été observée par rapport à 2022 s’agissant des animaux de rente qui intéressent 39 % des sinistres (majoritairement des bovins) alors que les chevaux enregistrent une légère hausse passant de 3 % à 5 % des sinistres enregistrés en 2023.
La part des litiges liés à la reproduction tous animaux confondus reste importante puisqu’elle représente :
- Un tiers des sinistres déclarés en 2023 pour des chiens et chats.
- Plus de 80 % des sinistres concernant les bovins.
Plus particulièrement pour ces derniers, près de trois quarts des litiges découlent de la réalisation de césariennes.
Analyse des experts
Marie-Emilie Petigny & Sophie Goeb, Juristes MACSF
Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire, consultant MACSF
Fait marquant sur la prise en charge des bovins, presqu’un tiers des sinistres déclarés en 2023 par les vétérinaires ruraux est lié à un défaut d’étanchéité des sutures utérines sur césarienne bovine.
S’agissant des autres litiges concernant les animaux de rente, trois relèvent d’actes d’anesthésie, deux d’interventions chirurgicales dont une intéressant la caillette. Trois dossiers concernent une prise en charge médicale.
La MACSF n’a enregistré qu’un seul sinistre lié à un drenchage, semblant signer une baisse du nombre de litiges liés à cette pratique.
Chez les chiens et les chats, une attention particulière doit être portée sur la stérilisation des femelles puisqu’elle est l’objet de 22 % des litiges concernant ces animaux, confirmant la hausse constatée l’année précédente. Un tiers de ces sinistres est lié à une rémanence ovarienne.
Le taux de sinistralité engendré par la rédaction de certificats reste stable après avoir semblé amorcer une baisse en 2022, tout comme celui lié à la garde, la contention ou la surveillance des animaux de compagnie.
Comme l’année précédente, près d’un quart des litiges initiés par les propriétaires d’animaux de compagnie relève d’actes de médecine. Parmi eux, onze sont une remise en cause du diagnostic posé.
Les actes de chirurgie sont visés dans près de 20 % des sinistres concernant les chiens et les chats et les actes d’anesthésie dans 6 % des cas, des taux qui restent stables.
Les litiges intéressant les chevaux sont divers, trois sont une remise en cause d’un diagnostic, deux relèvent d’un problème de contention.
En 2023, aucun sinistre n’a été déclaré pour des vaccinations, tous animaux confondus.
Enfin, alors qu’en 2022 aucun litige vétérinaire n’avait été porté devant les juridictions, en 2023, cinq font l’objet d’une procédure judiciaire.
Animaux de rente
Équins
Contention
- Prise en charge d'une jument pour lavage à la suite d’une infection utérine.
La jument a été attachée. Les attaches ont été mal positionnées et elle a glissé. Prise de panique, la jument s'est agitée et s'est retrouvée couchée sur le côté, la tête accrochée, la queue toujours attachée. L'incident a entraîné pour la jument des blessures au niveau des genoux et d’un postérieur (boulet, canon, jarret).
Contention non conforme aux bonnes pratiques. Responsabilité engagée.
Visite d'achat
- Lors d’une visite de contrôle avant une vente.
Le vétérinaire aurait dû confirmer l’uvéite du poney et indiquer au propriétaire le caractère de vice rédhibitoire de cette affection.
Responsabilité retenue pour défaut d’information.
Bovins
Césarienne
- Vêlage sur vache de race charolaise. Disproportion fœto-pelvienne.
Décision de césarienne. L'extraction du veau est difficile en raison de sa présentation par le dos. Il est habituellement d'usage de réaliser l'incision de l'utérus en regard des jarrets du veau afin de pouvoir l'extraire avec risque limité de déchirure utérine. Cela n'a pas été possible ici en raison de la position du veau dans l'abdomen de la vache et de son volume qui empêchait de le repositionner correctement. Il est alors décidé d'agrandir l'incision effectuée sur la grande courbure afin d'extérioriser les antérieurs et la tête. Le veau est extrait vivant. L’utérus s’est déchiré en direction du col utérin, sans saignement visible. Une partie de la plaie utérine ne peut être extériorisée. La suture était délicate à réaliser en raison de sa localisation proche du col utérin. L’utérus est suturé à l'aide de deux surjets. Le reste de l'intervention se déroule classiquement, et les suites immédiates sont normales.
Le lendemain la vache n'est pas en forme. Elle présente une pâleur marquée des muqueuses et meurt lors des soins. L'autopsie met en évidence un volumineux caillot sanguin dans l'utérus, dont l'origine est un vaisseau sanguin non ligaturé de la plaie utérine. La vache est morte d'une hémorragie utérine en lien avec un défaut d'hémostase sur la plaie utérine.
Responsabilité retenue (obligation de moyens non satisfaite, suture insuffisamment hémostatique).
- Le sociétaire est appelé la nuit pour un vêlage difficile (disproportion fœto-pelvienne).
Décision de césarienne. Veau extrait vivant. Intervention dans des conditions normales, double surjet utérin, hémostase parfaite.
Il est rappelé vingt jours plus tard car la vache ne semble pas aller bien. Elle meurt le jour-même.
L’autopsie révèle une infection pulmonaire sévère, non liée à un corps étranger mais à la généralisation d’un processus infectieux ayant possiblement pour origine un abcès abdominal sur la plaie chirurgicale interne de la paroi abdominale, et intéressant également la suture utérine. L’examen minutieux de celle-ci permet de constater sa parfaite réalisation.
Absence de faute, absence de responsabilité.
- Mort d'une vache de race charolaise à la suite d’une césarienne. Péritonite généralisée exsudative.
L'utérus présente une fistule à l'extrémité de la plaie utérine, permettant une communication entre l'utérus et l'abdomen. Ce défaut d'étanchéité de l'utérus peut parfaitement expliquer le développement de la péritonite fatale.
Suture utérine insuffisamment occlusive, le praticien a failli à son obligation de moyens, sa responsabilité est donc retenue.
- Péritonite fibrineuse mortelle après césarienne sur vache charolaise.
Des abcès sont localisés en zone pelvienne de l'abdomen et des adhérences à l'utérus sont également présentes. La suture utérine apparaît étanche.
Le praticien a répondu à son obligation de moyens en réalisant une suture utérine étanche. Une contamination de la cavité abdominale peut malgré tout se produire lors d'une césarienne : en effet, lors de ces chirurgies, compte tenu des conditions de l'intervention (propreté des lieux toute relative dans une stabulation...), il est bien évident qu'il est difficile d'avoir une asepsie parfaite. Les facteurs de risques sont pour la plupart indépendants des soins et de la qualité apportée à l'intervention.
Dans le cas de cette vache, le praticien a respecté les règles classiques d'asepsie. Il a également administré sans retard des antibiotiques et des anti-inflammatoires à la vache, de façon à prévenir au mieux tout problème infectieux.
Malheureusement, malgré toutes ces précautions la vache a quand même été victime d'une infection que les traitements médicaux n'ont pu éliminer. Pour autant, il ne peut en aucun cas être question d'attribuer cette complication infectieuse à une faute du vétérinaire : une contamination pendant la césarienne fait partie des aléas de cette intervention.
Le praticien a pratiqué cette intervention dans les règles, il ne peut en être tenu responsable.
- Vêlage avec excès de volume du fœtus et présentation postérieure.
Suite à un essai d'extraction il est établi qu'il ne peut sortir par les voies naturelles, d'où une décision de césarienne.
L'intervention se déroule tout à fait classiquement sans difficultés. Aucun saignement anormal n'est constaté. Douze heures plus tard la vache est revue en décubitus latéral, les muqueuses très pâles. Des caillots sanguins sont présents dans la litière de la case. Le vétérinaire provoque un prolapsus utérin pour examiner la plaie de césarienne mais ne constate pas de saignements. Le temps de préparer une transfusion, la vache est retrouvée morte.
Une autopsie est réalisée. Zone hémorragique en partie distale de la suture utérine. Dans le cas présent, malgré de bonnes conditions d'intervention, les sutures réalisées par le praticien se sont montrées insuffisamment hémostatiques. L’obligation de moyens n'a pas été respectée.
Responsabilité retenue pour défaut d'hémostase de la plaie utérine.
- Césarienne sur excès de volume fœtal.
L'intervention se déroule tout à fait classiquement sans difficultés. La vache est revue quatre jours plus tard pour anorexie avec hyperthermie et métrite. Malgré les soins entrepris et les contrôles effectués, son état se dégrade à nouveau et une laparotomie exploratrice est décidée au dixième jour. Une péritonite généralisée est constatée et conduit à une décision d’euthanasier l'animal en raison du pronostic désespéré et pour éviter des souffrances à l’animal.
Une autopsie est réalisée. La mort par péritonite est confirmée. On découvre une déhiscence de la suture utérine, à l'origine de l'infection.
Dans le cas présent, malgré de bonnes conditions d'intervention, les sutures utérines réalisées se sont montrées insuffisamment étanches. L'obligation de moyens n'a pas été respectée.
Responsabilité retenue pour défaut d'étanchéité de la plaie utérine.
Obstétrique : autres interventions
- Vêlage sur une génisse limousine. Présentation en siège.
Manœuvres de réduction. Puis le vétérinaire extrait le veau à l'aide d'une vêleuse sans difficulté particulière. Le veau naît mort. La vache délivre dans la foulée. Elle est fouillée après le vêlage sans que ne soit détectée d'anomalie.
L'éleveur rappelle deux jours plus tard car la vache n'est pas en forme. L’exploration vaginale permet de mettre en évidence une brèche utérine au plafond de l'utérus juste en arrière du col, de 10-15 cm. La génisse présente des signes évidents de péritonite : prostration, anorexie, signe du bras... Le vétérinaire recommande une euthanasie afin d'abréger les souffrances de l'animal.
L'origine incontestable de cette péritonite est la brèche utérine. La survenue de la plaie utérine, au vu de sa localisation, s'est produite lors de l'intervention.
La responsabilité du praticien est engagée pour défaut de moyens.
Administration de médicaments
- Administration mortelle d’un bolus.
Le praticien intervient sur une vache bretonne pie noire qui présente une "fièvre de lait". Après la perfusion, la vache se relève et le praticien décide d’administrer un bolus de calcium. Dans les minutes qui suivent, la vache meurt brutalement. Une fausse route du bolus dans la trachée est suspectée.
Une autopsie a été réalisée. Elle a permis de confirmer la mort par asphyxie et la présence d’un enduit blanchâtre en petite quantité dans la trachée pouvant correspondre au bolus délité. - L’administration ayant été réalisée par le praticien, sa responsabilité est directement engagée.
- Administration d’une perfusion calcique.
Deux veaux morts ont été extraits par césarienne sur une vache laitière. Celle-ci reste couchée. Le praticien suspecte une fièvre vitulaire comme étant à l’origine de cette parésie, il administre un soluté calcique. Le lendemain, la vache est toujours couchée, en décubitus sternal. Après examen clinique, le praticien pense que la vache est toujours en hypocalcémie. Il effectue une prise de sang pour mesurer la calcémie et la phosphorémie à son retour à la clinique. Mais sans attendre le résultat d’analyse, il perfuse l’animal avec un soluté calcique. En fin de perfusion, la vache présente un essoufflement brutal puis un collapsus cardio respiratoire. Elle meurt rapidement.
Le vétérinaire effectue l’analyse prévue à son retour à la clinique, en partie pour justifier sa décision. Mais les résultats sont sans appel : les teneurs en calcium et en phosphore sont dans les normes habituelles ; la perfusion du soluté était donc inutile… et dangereuse.
Le risque est connu et inhérent à cette thérapeutique. La "bonne pratique" aurait été de soumettre cette administration aux résultats de l’analyse sanguine.
La responsabilité du praticien est engagée.
Animaux de compagnie
Chats et chiens
Chirurgie gynécologique et obstétricale
- Ovariectomie d’une chatte.
Le vétérinaire pratique une ovariectomie de convenance sur une chatte. Deux jours plus tard le propriétaire constate une masse volumineuse en regard de plaie chirurgicale. Une radio est effectuée. Il est conclu à l’absence de hernie et l’existence d’une collection inflammatoire. Un traitement est prescrit.
Quatre jours plus tard (jour férié), le propriétaire consulte en urgence une structure spécialisée. L’urgentiste qui examine la chatte diagnostique cette fois une hernie abdominale sur le site opératoire. Il propose d’intervenir, mais le propriétaire préfère recourir au service de son vétérinaire traitant. Celui-ci réopère la chatte le lendemain...
Deux jours plus tard la chatte est ramenée à la clinique pour nouvelle masse volumineuse en regard de la cicatrice, elle est prise en charge par un associé dans le même établissement : la paroi musculaire présente un début de nécrose provoqué par les points séparés placés sur la paroi musculaire, ces points sont bien trop serrés. Le praticien pare la plaie musculaire et réalise une suture abdominale. La chatte est hospitalisée plusieurs jours. Malgré ces précautions, la plaie présente à nouveau une déhiscence.
L’animal est alors référé à une structure spécialisée : il y est opéré à nouveau et hospitalisé pendant dix jours. Tout finit par rentrer dans l’ordre. Les trois premières sutures réalisées, trop serrées, génératrices d’ischémie et de nécrose, ont été considérées comme non conformes aux bonnes pratiques.
La responsabilité des praticiens de l’établissement a été retenue.
- Ovario-hystérectomie de chienne (compresse oubliée).
Pour raison de métrite, une ovario-hystérectomie a été réalisée sur une chienne.
Une compresse aurait été oubliée lors de l’intervention ; la chienne a dû subir une nouvelle intervention pour ablation d’une masse ; le propriétaire demande le remboursement des frais occasionnés par la nouvelle intervention.
L’analyse histologique a écarté une origine tumorale et mis en évidence des résidus de corps étranger. La présence résiduelle d’une compresse est indéniable. Oublier une compresse constitue une faute chirurgicale dont le praticien est directement responsable.
Responsabilité engagée.
- Cas de rémanence ovarienne.
Une chienne d'élevage est présentée en urgence pour pyomètre/métrorragie. Elle est opérée en urgence : intervention d'ovario-hystérectomie délicate en raison de la présence d'adhérences consécutives aux césariennes passées et de kystes utérins.
La chienne se rétablit bien. Trois mois plus tard, elle est présentée pour des pertes vulvaires hémorragiques. L'échographie met en évidence un épaississement du moignon utérin. Suite au traitement antibiotique, le problème persiste, d'où, deux mois plus tard, une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une exérèse d'un reliquat de pédicule ovarien et du col utérin.
L'histologie des pièces d'exérèse confirmera la suspicion de rémanence ovarienne. La chienne est en bon état de santé et ne présente plus de signes cliniques.
La chienne a développé son infection du moignon utérin consécutivement à la rémanence ovarienne. En effet ce type de pathologie est extrêmement rare sur une chienne stérilisée, le mécanisme d'apparition de cette pathologie étant intimement lié au cycle hormonal de la chienne.
Ainsi, il est raisonnable d’estimer que si l'ovariectomie avait été complète, la chienne n'aurait pas fait cette métrorragie. Lors d'une ovario-hystérectomie, le chirurgien est tenu de réaliser une exérèse complète des deux ovaires et de l'utérus. La responsabilité du praticien est donc engagée.
Responsabilité retenue pour rémanence ovarienne suite à une intervention d'ovario-hystérectomie.
- Autre cas de rémanence ovarienne.
Une chienne est stérilisée en mars. Le praticien ne se souvient pas d’avoir rencontré de difficulté opératoire particulière. Cinq mois plus tard, la chienne manifeste un comportement de chaleurs. Le praticien propose de réopérer la chienne afin de vérifier la persistance de tissu ovarien. La propriétaire préfère attendre le retour d’autres chaleurs. Elle déménagera entre temps et la chienne est désormais suivie par un autre praticien. Celui-ci fait pratiquer une échographie abdominale de la chienne par un confrère qui diagnostique la persistance de l’ovaire droit, en position anatomique. Le praticien opère la chienne et retire l’ovaire.
L'ovariectomie est une intervention de convenance et, qui plus est, très courante. A ce titre, une quasi obligation de résultat quant à son objet (le retrait des ovaires) est attendue. On ne saurait s’exonérer de cette obligation en raison d’une quelconque particularité technique ou anatomique.
La responsabilité du praticien est retenue.
- Mort d'une chatte après ovariectomie.
Un chaton maine coon est présenté pour une stérilisation précoce avant sa vente. L'intervention se déroule sans difficultés.
La chatte est représentée huit jours plus tard pour déhiscence de la plaie cutanée et musculaire. Elle est anesthésiée à nouveau afin de reprendre la suture. L'opération se déroule bien mais alors que le praticien termine sa suture, la chatte fait un arrêt cardiaque. Les manœuvres de réanimation ne permettront pas d'éviter la mort du chaton.
À la suite de la première intervention, la chatte avait été bien surveillée par sa propriétaire pour éviter les complications, avec une attention particulière pour empêcher le léchage de la plaie. La suture cutanée s'est, dans un premier temps, défaite puis, malgré la mise en place d'un pansement, la suture du muscle n'a pas tenu. Le pansement était alors encore en place, attestant que le chat n'avait pu lécher exagérément la plaie et donc qu'il ne pouvait pas être à l'origine de la déhiscence constatée.
Dans ces conditions, le défaut de suture est imputable au chirurgien. Le praticien a donc assumé sa responsabilité en reprenant la plaie sous anesthésie générale.
Malheureusement la chatte est morte lors de cette seconde intervention, probablement d'un choc anesthésique, aléa rare mais bien connu de l'anesthésie générale.
Le praticien étant reconnu responsable de la déhiscence de la suture, le décès est directement lié à cette complication puisque cet aléa n'aurait pu se produire si le chaton n'avait pas eu besoin d'être réopéré.
Responsabilité retenue pour défaut de suture lors d'une intervention de convenance.
Autres soins
- Plaie due à un pansement.
Le praticien est consulté pour une boiterie du postérieur droit sur une chienne. Une radio révèle la fracture de 2 phalanges. Une immobilisation par pansement de Robert Jones est préconisée et réalisée. L'animal est placé sous antalgique et un rendez-vous de retrait est convenu six semaines plus tard.
Toutefois deux semaines plus tard la chienne présente à nouveau de la boiterie. Elle est revue par un associé du premier praticien qui enlève le pansement et refait la radio. Aucune anomalie n’étant présente, le pansement est changé et l’animal rendu avec un traitement antalgique à nouveau. Le rendez-vous à six semaines est maintenu. Mais deux semaines plus tard la chienne boite à nouveau et son pansement semble la gêner (mordillement). La propriétaire, sentant une odeur nauséabonde, décide d’ôter le pansement elle-même : une plaie suppurante est présente au niveau du coussinet. Le lendemain, elle consulte auprès d’une autre clinique pour la prise en charge de cette plaie. La plaie est parée chirurgicalement et fera l’objet de séances de traitement laser pour la cicatrisation.
La propriétaire reproche aux deux praticiens associés l’absence de suivi régulier. Les plaies de nécrose constituent le risque majeur des pansements de Robert Jones. En effet, la compression assurée par le pansement doit permettre une stabilisation maximale du membre et éviter l’œdème, mais cette nécessité expose possiblement à une compression trop importante de certaines zones. Ces compressions entraînent une dévascularisation au sein de ces zones, responsables de la plaie. Il s’agit donc d’un pansement technique dont la maîtrise est indispensable et qui doit faire l’objet d’un changement régulier (au maximum tous les 10 jours).
Il doit aussi être réalisé une information claire concernant ces risques et les signes évoquant la nécessité de procéder à un changement immédiat du pansement (douleur, glissement du pansement, humidité, mordillement, ...).
Responsabilité retenue pour défaut de suivi et d’information.
- Surdosage médicamenteux.
La praticienne intervient à domicile pour soigner un chien atteint d'une gastro-entérite aiguë avec hypotension et hypovolémie. Un traitement symptomatique est mis en œuvre ainsi qu'une fluidothérapie de solutés isotoniques et hypertoniques. Rapidement au cours de la perfusion, le chien commence à présenter des signes neurologiques (ataxie, désorientation) et n'est plus ambulatoire.
La praticienne réalise, une fois repartie, avoir administré le soluté hypertonique en quantité trop importante. Elle comprend alors l'origine des désordres neurologiques ayant débuté avant même son départ du domicile de ses clients. Elle rappelle les propriétaires qui ont déjà emmené leur chien dans un centre d'urgence vétérinaire. Une hypernatrémie et hyperchlorémie sévères sont mises en évidence et un traitement est entrepris en hospitalisation. Il est transféré le lendemain matin dans un autre établissement de soins vétérinaires qui effectue la suite des soins.
L'évolution sera favorable.
Les solutés hypertoniques s'utilisent en quantité limitée. Les symptômes apparus correspondent exactement à un surdosage en soluté hypertonique. La dose recommandée est de 90 à 150 ml pour un chien de 30 kg, or il a reçu 500 ml, ce qui explique le déclenchement de l'hypernatrémie et de l'hyperchlorémie.
Responsabilité retenue pour surdosage médicamenteux.
- Complication de laparotomie sur une lapine.
Une lapine est opérée à la suite d’une occlusion digestive. La gastrotomie permet d’évacuer un trichobézoard (boule de poils). Quelques jours plus tard, la propriétaire consulte un autre vétérinaire car la lapine présente des difficultés pour s’alimenter. L’animal est hospitalisé en soins intensifs.
Au 4e jour d’hospitalisation, une hernie abdominale est mise en évidence. L’état général s’améliore au cours des soins pour permettre une laparotomie. La lapine récupère. La propriétaire est mécontente des complications survenues.
Dans la mesure où la suture musculaire a lâché, la responsabilité du praticien est engagée. Mais les trois premiers jours d’hospitalisation ne sont pas en lien avec la survenue de la hernie qui n’est apparue que le 4e jour.
La responsabilité du praticien n’est donc retenue que pour les frais de prise en charge de la complication de hernie.
Certificats, formalités
- Certificat vétérinaire avant cession d’un chiot.
Le vétérinaire se voit mis en cause dans le cadre d’un litige opposant le vendeur à l’acheteuse. Celle-ci argue d’un défaut congénital supposément constaté sur le chiot pour obtenir remboursement de la part du vendeur, du prix d’acquisition de l’animal, des frais engendrés, d’un préjudice moral... Celui-ci se retourne contre le vétérinaire, pour obtenir la prise en charge de tout ou partie des frais qui lui sont réclamés, au motif, que le certificat rédigé par le praticien ne portait pas mention de ce supposé défaut.
Au moment de l’examen conduit par le praticien, l’animal n’a pas manifesté le moindre ronflement. Il n’a pas, non plus, relevé de dyspnée ou de cyanose. Ce qui est tout à fait envisageable, étant donné le caractère aléatoire de la symptomatologie liée à l’élongation du voile du palais. Le vendeur n’a, quant à lui, nullement signalé avoir entendu un quelconque bruit respiratoire anormal sur ce chiot. Le contrat de soins repose sur un devoir d'information du professionnel de santé vétérinaire envers le détenteur de l’animal mais, et ce point est trop souvent négligé, il y a aussi un devoir d’information de celui-ci envers celui-là. S'il s 'avère que le vendeur a tu, volontairement ou par négligence, avoir remarqué un bruit respiratoire anormal sur cette chienne, il en sera tenu pour seul responsable.
Ainsi, en l’absence de tout signe clinique, qu’il aurait pu relever lui-même, ou rapporté par le propriétaire vendeur, le praticien n’avait aucune raison de suspecter l’existence d’une telle pathologie sur ce chien, suspicion dont, bien évidemment, il ne pouvait faire mention sur son certificat.
Le praticien n‘avait aucune raison de mentionner une suspicion d’élongation du voile du palais, encore moins le diagnostic d’une telle pathologie.
Son certificat ne peut être légitimement mis en cause.
Garde juridique, contention
- Fractures dentaires lors d’une hospitalisation.
Un chien est hospitalisé pour la journée afin de réaliser des radios car il présente une boiterie d’un antérieur. Il est rendu le soir même avec des anti-inflammatoires pour traiter sa panostéite. Les jours suivants, le chien montre des difficultés à s’alimenter. Le propriétaire se rend alors compte que deux incisives supérieures sont fracturées. Le chien a présenté des signes de gêne dès son retour d’hospitalisation, il estime donc que la fracture a dû avoir lieu durant l’hospitalisation en mordant les barreaux de sa cage. La pulpe dentaire étant mise à nue, une antibiothérapie est mise en place jusqu’aux soins dentaires.
Le chien a ensuite été pris en charge par un spécialiste en dentisterie. Il a réalisé des radios dentaires, la dévitalisation et la pose d’une résine composite pour oblitérer les canaux dentaires.
L’âge, le tempérament du chien et les lésions, concordent, selon les vétérinaires, avec un comportement de mordillement des barreaux de la cage. Il est donc tout à fait possible que le chien ait fracturé ses deux incisives lors de son hospitalisation. Il a été considéré ici que la situation renvoyait au contrat de dépôt. Cas de figure où la responsabilité est contractuelle avec une obligation de résultat du dépositaire qui doit rendre l’animal dans l’état dans lequel il l’a reçu. Le vétérinaire a alors la charge de la preuve qu’aucune erreur n’a été commise.
Responsabilité retenue.
- Fracture mandibulaire due à la contention.
La praticienne reçoit en consultation une chienne Chihuahua pour un 2e avis sur un problème de toux. Après l'examen clinique, elle propose une radiographie du thorax afin d'explorer la cause de la toux.
Malheureusement, dès que la chienne arrive en salle de radiologie, elle se montre agressive et essaie de mordre. Souhaitant éviter de la museler et/ou de l'anesthésier tant que l'origine des problèmes respiratoires n'est pas élucidée, la praticienne s'équipe de gants en cuir pour effectuer la radiographie. La chienne mord à plusieurs reprises dans les gants lors de la séance. Une bronchite est diagnostiquée et un traitement est mis en place. La propriétaire revient l'après-midi même car la chienne hurle dès qu'elle ouvre la gueule. La radiographie, sous anesthésie générale cette fois, met en évidence une fracture mandibulaire gauche. La chienne est référée dans un autre établissement de soins vétérinaires pour une pose de plaque.
Lors de la réalisation d'une radiographie, l'animal est sous la responsabilité du praticien, qui seul ou aidé d'un auxiliaire, effectue la contention nécessaire à cet examen. Dans le cas présent, la chienne se montrait très agressive, et la vétérinaire devait faire en sorte, d'une part de se protéger, elle ainsi que son personnel, d'une éventuelle morsure ; d’autre part d'éviter toute méthode de contention potentiellement dangereuse pour la santé de la chienne dans le cas où celle-ci serait atteinte d'une éventuelle pathologie cardiaque et/ou respiratoire. Ainsi le port de la muselière et l'anesthésie générale ne paraissaient pas adaptés en raison du stress et de la potentielle apnée qui en auraient découlé. La vétérinaire a donc fait le choix d'une contention à l'aide de gants de cuir que la petite chienne ne s'est pas privée de mordre autant qu'elle le pouvait. Selon toute vraisemblance, c'est la violence de ces tentatives de morsure qui a occasionné la fracture mandibulaire (l'âge avancé de cette chienne de tout petit format explique sans doute la fragilité osseuse).
Bien qu'une fracture des mandibules puisse sembler imprévisible dans ces conditions, la responsabilité de la praticienne est cependant engagée. En effet la chienne était sous sa garde. Compte tenu de son caractère agressif, la vétérinaire aurait pu choisir de renoncer à l'examen dans ces conditions, au motif que le comportement de la chienne les mettait toutes deux en danger (hématome à la main malgré le gant), et proposer une anesthésie générale préalable avec les risques que cela comportait. À la propriétaire d'accepter ou non ces risques. À noter que c'est d'ailleurs ce qu'elle aurait fait avec tout autre chien de gabarit supérieur puisque les gants de cuir n'offrent une protection "suffisante" que pour les tout petits gabarits.
Responsabilité retenue pour contention non adaptée en raison du caractère très agressif de la chienne.
Le saviez-vous ?
Des décisions de justice et des avis CCI
ont été rendus en 2023 dans votre spécialité.
Découvrez les éléments-clés
(nombre de mis en cause, taux de condamnation, montants d'indemnisation)