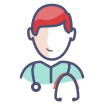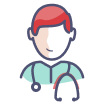Un accident anesthésique au cours d'un mini lifting
Une patiente subit un mini lifting sous anesthésie générale.
Après l’induction anesthésique, l’anesthésiste s’absente du bloc à plusieurs reprises, y repassant néanmoins à intervalles réguliers (11h30, 11h45, 11h55 et 12h10). Dans l’un de ces intervalles, le chirurgien est amené à effectuer une rotation de la tête de la patiente pour opérer le côté gauche, au risque de déplacer la sonde d’intubation, mais l’expertise démontrera que ce risque ne s’est pas réalisé.
Après 12h10 se produit une alerte cardiaque, prise en charge dans un premier temps par les infirmiers du bloc qui participent aux manœuvres de réanimation, puis, dans un second temps, par l’anesthésiste qui a été appelé et est intervenu très rapidement.
Malgré les manœuvres entreprises, la patiente décède.
Ses ayants droit poursuivent le chirurgien au pénal, pour homicide involontaire.
L’expertise pénale conclut à une mauvaise tolérance hémodynamique de l’anesthésie et à des troubles du rythme cardiaque déclenchés par le Sevoflurane, produit d’entretien de l’anesthésie, qui aurait exigé une surveillance vigilante du scope.
Les absences répétées du bloc du médecin anesthésiste sont qualifiées par l’expert d’imprudence notoire.
Le chirurgien condamné en tant qu’auteur indirect
L’expert ayant écarté l’hypothèse du déplacement de la sonde d’intubation lors de la rotation de la tête, la responsabilité pénale du chirurgien ne peut être recherchée en tant qu’auteur direct du dommage.
En revanche, la question de sa responsabilité pénale indirecte se pose, pour ne pas avoir interrompu l’intervention alors qu’il constatait le défaut de présence continue de l’anesthésiste.
- La Cour d’appel déboute les ayants droit et relaxe le chirurgien, considérant que celui-ci ne disposait d’aucun pouvoir de direction sur l’anesthésiste, qu’il ne pouvait obliger à être présent en continu dans la salle.
Le fait de ne pas avoir mis fin à l'intervention au seul constat de l'absence discontinue de son confrère ne peut donc engager sa responsabilité professionnelle. - La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel, par une décision du 12 juillet 2016.
A l’inverse, elle indique que, si la surveillance opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n’en demeure pas moins tenu, à cet égard, d’une obligation générale de prudence et de diligence.
Il appartenait au chirurgien de cesser immédiatement l’intervention qui, faute de surveillance clinique continue, ne présentait pas les garanties suffisantes de sécurité et exposait la patiente à un risque d’une particulière gravité, que le chirurgien ne pouvait ignorer et qui s’est d’ailleurs réalisé.
Une décision surprenante…
L’article D. 6124-94 du code de la santé publique (CSP) impose, pour la réalisation d’une anesthésie, une "surveillance clinique continue".
La Cour de cassation en a déduit que cette obligation n’avait pas été respectée dans le cas présent, puisque l’anesthésiste s’est absenté à plusieurs reprises.
Et c’est sur cette constatation qu’elle a considéré que le chirurgien avait commis une faute, en tant qu’auteur indirect, en faisant le choix de poursuivre l’intervention.
Cette position paraît surprenante, car si les textes imposent bien une surveillance continue, ils n’imposent pas, en revanche, que cette surveillance soit assurée par l’anesthésiste en personne.
Les recommandations de la SFAR concernant "la surveillance des patients en cours d'anesthésie" (2e édition - Juin 1989-Janvier 1994) précisent que :
"Toute anesthésie générale, locorégionale, ou sédation susceptible de modifier les fonctions vitales doit être effectuée et surveillée par ou en présence d'un médecin anesthésiste-réanimateur qualifié. (...) Si le médecin anesthésiste-réanimateur est amené à quitter la salle d'opération, il confie la poursuite de l'anesthésie à un autre médecin anesthésiste-réanimateur qualifié. S'il la confie à un médecin anesthésiste-réanimateur en formation ou à un(e) infirmier(e) anesthésiste, il reste responsable de l'acte en cours et peut intervenir sans délai".
Les recommandations de la SFAR de janvier 1995 sur le rôle de l’IADE ont également prévu que :
"Le médecin anesthésiste-réanimateur peut lui confier la surveillance du patient en cours d'anesthésie à la condition expresse de rester à proximité immédiate et de pouvoir intervenir sans délai".
Il ressort de ces textes que seule la surveillance de l’anesthésie est obligatoire, surveillance qui peut être exercée par un IADE, dès lors que l’anesthésiste reste disponible rapidement.
—
Le fait que l’anesthésiste n’ait pas été présent en continu ne constitue donc pas, en soi, une faute.
En l’espèce, l’anesthésiste est passé quatre fois en salle, par intervalles de 10 à 15 minutes. Lorsque l’arrêt circulatoire s’est produit, il est intervenu rapidement.
Peut-être l’explication réside-t-elle dans la qualification des infirmiers présents en salle. L’arrêt d’appel mentionne des "infirmiers de bloc participant aux manœuvres de réanimation", formule vague qui ne permet pas de dire s’il s’agissait d’IADE.
- Dans l’affirmative, en présence d’IADE dans la salle et d’un anesthésiste susceptible d’intervenir rapidement, les textes étaient respectés, et la condamnation du chirurgien apparaît alors contestable.
- Si, en revanche, il ne s’agissait pas d’IADE, mais d’infirmiers de bloc qui ont réalisé les premières manœuvres de réanimation, alors cette décision paraît plus logique.