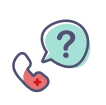Quelle est la finalité de la procédure civile ?
L’objectif pour la victime est d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi consécutivement à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Contrairement à la procédure pénale, la procédure civile n’aboutit pas à une sanction.
Dans le domaine de la responsabilité médicale, la réparation du dommage consiste, le plus souvent, en une indemnisation sous forme pécuniaire, destinée à réparer le préjudice subi.
Quelles sons les juridictions compétentes ?
- En première instance, les tribunaux judiciaires sont compétents (ex-tribunaux d’instance et tribunaux de grande instance, qui ont été fusionnés au 1er janvier 2020).
- La Cour d’appel est compétente en cas d’appel interjeté par l’une des parties.
- En cas de pourvoi, l’affaire est jugée (en droit mais pas en fait) par la Cour de cassation.
Qui est civilement responsable ?
- Les professionnels de santé libéraux sont personnellement responsables sur le plan civil, en raison de l’indépendance professionnelle dont ils jouissent dans leur exercice.
- Les professionnels de santé salariés ne sont personnellement responsables que s’il est établi qu’ils ont agi en dehors des missions confiées par leur employeur, hypothèse rarement retenue par la jurisprudence. Dans tous les autres cas, le commettant (ou employeur) est civilement responsable et supporte les condamnations pécuniaires prononcées.
- Les professionnels de santé exerçant dans des établissements publics ne sont pas personnellement responsables sur le plan indemnitaire. La victime, qui n’est pas liée par un contrat aux agents du service, doit mettre en cause la responsabilité administrative de l’établissement hospitalier pour une faute de service, devant le juge administratif.
Quelles sont les grandes étapes d'une mise en cause devant le juge civil ?
La procédure peut varier selon la nature et la complexité de l’affaire. Nous décrivons ici les étapes les plus fréquemment rencontrées dans les affaires de responsabilité médicale.
- La procédure débute le plus souvent par une assignation, en référé ou au fond, devant le juge judiciaire. C’est le domicile du défendeur qui est pris en considération pour déterminer quel tribunal est compétent territorialement.
- Compte tenu de la complexité des affaires en matière de responsabilité médicale, il est souvent désigné un médecin expert pour retracer les étapes de la prise en charge et analyser les comportements des mis en cause. Il mène ses opérations d'expertise médicale contradictoirement, en présence de toutes les parties.
- L’expert dépose un pré-rapport si sa mission le prévoit, pour recueillir les observations des parties sous forme de dires, puis un rapport définitif portant une appréciation sur les fautes éventuellement commises (mais pas sur les responsabilités : il s’agit d’une notion juridique réservée au juge).
- C’est à ce stade qu’une véritable discussion contradictoire s’instaure devant le juge, via le dépôt de conclusions au soutien des prétentions de chacune des parties impliquées.
- Le juge tranche le litige par un jugement qui se prononce sur les responsabilités et, le cas échéant, sur les condamnations.
Quel est le rôle de l'assureur ?
L’assureur en responsabilité civile professionnelle prend en charge les indemnisations allouées par le juge, jusqu’à concurrence du plafond mentionné au contrat.
Il prend en charge les honoraires de l’avocat choisi pour défendre le professionnel de santé.
Peut-on engager sa responsabilité civile en l'absence de toute faute ?
En matière de responsabilité médicale, le principe est la responsabilité pour faute, posé à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.
Pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé, le patient doit donc prouver :
- que ce professionnel a commis une faute,
- le dommage qui en résulte,
- le lien de causalité entre les deux.
Dans certains cas, la loi prévoit une exception à ce principe : il est alors considéré que le mis en cause engage sa responsabilité, même en l’absence de toute faute.
Par exemple, les établissements de santé sont considérés comme responsables de plein droit en cas d’infection nosocomiale.
Quels sont les recours possibles contre une décision ?
- Il peut être fait appel d’un jugement, devant une Cour d’appel.
Les juges d’appel réexaminent l’affaire, en fait et en droit.
L’appel est suspensif de l’exécution de la décision de première instance, sauf si l’exécution provisoire a été prononcée, sur tout ou partie des sommes allouées.
La Cour d’Appel peut confirmer le jugement ou, au contraire, l’infirmer. - L’arrêt d’appel, peut, à son tour, faire l’objet d’un recours, formé par pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation ne juge qu’en droit, c’est-à-dire qu’elle contrôle la bonne application de la règle de droit par les juges du fond. Elle ne rejuge pas les faits ; tout au plus peut-elle leur donner une qualification juridique différente.
La cassation n’est donc pas un troisième degré de juridiction.
A l’issue de cette procédure, l’arrêt d’appel peut être cassé ou confirmé si le pourvoi est rejeté.
Pendant combien de temps peut-on être mis en cause devant une juridiction civile ?
Le délai de prescription de l’action civile en matière de responsabilité médicale est fixé à 10 ans à compter de la consolidation du dommage (article L.1142-28 du Code de la santé publique), pour les actes de soins dispensés à compter du 5 septembre 2001.
Ce délai de prescription est difficile à fixer avec précision car son point de départ est fluctuant : il s’agit de la date à laquelle l’état de la victime est considéré comme stabilisé.
Le délai peut de surcroit être interrompu ou suspendu par certains événements (mesure d’instruction, tentative de médiation, etc.).