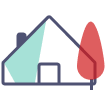Le principe : illégalité de l’enregistrement clandestin
L’article 9 du Code civil précise que "chacun a droit au respect de sa vie privée".
Il découle de ce droit que l’on ne peut enregistrer une personne sans son consentement.
En effet, enregistrer quelqu’un pendant une conversation privée ou confidentielle, sans son accord préalable, est illégal et réprimé d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende par l’article 226-1 du Code pénal.
Néanmoins, bien qu’illégaux, ces enregistrements peuvent être utilisés en justice, à certaines conditions.
—
Au pénal : quelle recevabilité d’une preuve déloyale ?
Devant les juridictions pénales, la preuve est libre.
Selon l’alinéa 1er de l’article 427 du Code de procédure pénale, "hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction".
La Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que les personnes privées peuvent lors d’un procès pénal apporter la preuve d’une infraction, même obtenue de manière déloyale ou illégale (Cass. Crim., 1er décembre 2020, n° 20-82.078).
 Par conséquent, les juges reconnaissent que des enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne pour porter plainte contre elle sont recevables en justice (Cass. Crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464).
Par conséquent, les juges reconnaissent que des enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne pour porter plainte contre elle sont recevables en justice (Cass. Crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464).
Au civil : principe de licéité et loyauté de la preuve
Devant les juridictions civiles, la preuve doit être licite et loyale
L’article 9 du Code de procédure civile précise que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
 Par conséquent, les juges civils ont pu établir que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant la preuve obtenue irrecevable en justice (Cass. Civ., 2e, 7 oct. 2004, n° 03-12.653, Cass. Com., 3 juillet 2008, n° 07-17.147).
Par conséquent, les juges civils ont pu établir que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant la preuve obtenue irrecevable en justice (Cass. Civ., 2e, 7 oct. 2004, n° 03-12.653, Cass. Com., 3 juillet 2008, n° 07-17.147).
À titre d’exemple, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu considérer que, bien que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, l’enregistrement d’images ou de paroles à leur insu, au moyen de caméras dissimulées dans une caisse, constitue un mode de preuve illicite. Dès lors, ces enregistrements n’ont pu être utilisés comme preuve pour retenir la faute grave de la salariée. (Cass. Soc., 20 nov 1991, n° 88-43.120).
Néanmoins, ces dernières années, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), les juridictions civiles ont eu tendance à mettre en balance le droit de la preuve, le droit au respect de la vie privée et la loyauté de la preuve pour admettre comme preuve des enregistrements clandestins.
Évolution jurisprudentielle : l’admission des enregistrements clandestins en matière civile sous certaines conditions
La jurisprudence récente de la Cour de cassation (en matière civile, sociale ou commerciale) admet que l’enregistrement clandestin n’est pas nécessairement écarté des débats (Cass. Ass. Plén du 22 decembre 2023, n° 20-20.648 ; Cass. Soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474 ou Cass. Soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).
Plusieurs conditions cumulatives sont appréciées par les juges afin d’admettre la recevabilité de l’enregistrement clandestin :
- Sa production doit être indispensable à l’exercice du droit de la preuve ;
- L’atteinte aux autres droits antinomiques en présence doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Illustration
Un salarié déclare avoir été victime de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société qui l’emploie. Lors du procès, la victime produit notamment un procès-verbal d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits. L’enregistrement des propos tenus par le gérant ayant été réalisé à son insu, ce dernier estime que la preuve a été obtenue de manière déloyale.
Dans un arrêt du 6 juin 2024, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a bien recherché, comme elle le devait, si l’utilisation de l’enregistrement des propos, réalisé à l’insu de leur auteur, portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Pour ce faire, elle a mis en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime.
Elle rejette donc le pourvoi au motif que "la cour d’appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci, et que l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l'employeur" (Cass. civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736).