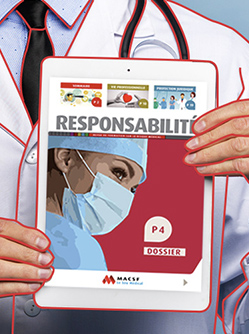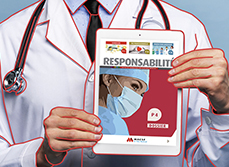Notion de maladie émergente
La maladie Covid-19 est assurément une maladie nouvelle. C’est une maladie émergente, au même titre que le SRAS en 2003, dû à un bêta-coronavirus proche.
Pour l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA ou WOAH), une maladie émergente est en effet "une infection nouvelle, causée par l’évolution ou la modification d’un agent pathogène ou d’un parasite existant, qui se traduit par un changement d’hôtes, de vecteurs, de pathogénicité ou de souche." Il peut s’agir également d’une maladie infectieuse non encore signalée.
Charles Nicolle (prix Nobel de médecine 1928) s’était particulièrement intéressé à ce qu’il appelait alors les maladies nouvelles. Plus de la moitié des maladies émergentes sont des maladies bactériennes, un quart sont des maladies virales, les autres se répartissent entre protozooses, mycoses et helminthoses.
La "grippe aviaire", pour certains de ses variants seulement, a pu être considérée comme une maladie humaine émergente. Des septicémies nosocomiales peuvent être considérées comme telles. L’encéphalite à tiques est une maladie émergente lorsqu’elle change de vecteur et peut apparaître en France dans le cadre de contaminations par ingestion de lait cru... Des maladies nouvelles en ce qu’elles quittent leur berceau tropical sont qualifiées d’émergentes ; c’est évidemment un point de vue centré depuis l’Occident...
Notion de zoonose
Le terme a été créé par le médecin allemand Rudolph Virchow au milieu du XIXe siècle.
Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice versa. Les agents pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus, des parasites (protozoaires, cestodes, trématodes, nématodes), des champignons microscopiques ou des agents non conventionnels comme le prion.
La transmission de ces maladies se fait :
- soit directement, lors d'un contact entre un animal et un être humain (par exemple une dermatomycose à partir du contact avec un chat) ;
- soit indirectement, notamment par voie alimentaire (exemple de la maladie de Creutzfeld-Jacob, variant ESB) ou par l’intermédiaire d'un vecteur (insecte, arachnides…).
Les maladies vectorielles semblent progresser avec le dérèglement climatique (arboviroses par exemple).
A noter que les zoonoses englobent aussi les maladies infectieuses d’origine animale avec réservoirs animaux, dans lesquelles la transmission peut évoluer et devenir directement interhumaine ; c’est le cas du SIDA (HIV), de la fièvre hémorragique virale Ebola…
Certaines zoonoses peuvent comporter une transmission interhumaine indirecte à partir de supports inertes (Ebola, covid-19).
Les maladies communes à l’homme et à certaines espèces animales, sans transmission entre les espèces, ne rentrent pas à proprement parler dans le champ des zoonoses. C’est par exemple le cas du tétanos.
Il est d’ores et déjà important de souligner la diversité de ces maladies communes à l’homme et aux (autres) animaux vertébrés :
- diversité des agents pathogènes ;
- diversité des réservoirs animaux (reptiles, oiseaux, mammifères), diversité des vecteurs (moustiques, tiques...);
- diversité de gravité médicale, de fréquence ;
- diversité géographique.
Pour revenir un instant au cas de la Covid-19, le réservoir de virus est très probablement animal. Le virus SarS-CoV-2 est très proche d’un virus détecté chez une chauve-souris, réservoir et porteur sain de très nombreux virus.
L’animal à l’origine de la transmission à l’homme n'a pas encore été identifié, l’hypothèse initiale du pangolin n’ayant pas été confirmée. On peut affirmer sans prendre de grands risques que la pandémie est une zoonose, l’adaptation d’un virus hébergé par un réservoir animal s’étant faite à l’homme en Asie à l’occasion de rapprochement des espèces.
Aujourd’hui, même si la démonstration de cas d’infection d’animaux d’espèces domestiques ou sauvages a été faite, la transmission est essentiellement sinon exclusivement interhumaine, la contagion ayant lieu pour l’essentiel par voie respiratoire.
Si on veut, à l’inverse d’une fixation sur l’actualité, prendre du recul pour comprendre, il est intéressant d’observer qu’il y a eu assurément une première vague de zoonoses avec la sédentarisation d’Homo sapiens et la domestication animale et qu’il y en a une seconde avec l’explosion démographique humaine, le réchauffement climatique, le déséquilibre des écosystèmes induits par l’homme et la mondialisation des échanges.
Parmi les facteurs d’émergence des zoonoses, on peut citer aussi la refonte des systèmes agraires, l’agriculture et l’élevage intensifs, l’homogénéité des souches aviaires exploitées en élevages intensifs, les trafics d’animaux exotiques, le développement des marchés d’animaux vivants, la consommation culturelle d’animaux exotiques, la mode des nouveaux animaux de compagnie...
Importance des zoonoses
Les maladies transmissibles des animaux à l’homme sont extrêmement nombreuses et importantes à considérer.
- 60 % des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques.
- 75 % des agents pathogènes des maladies infectieuses émergentes de l’homme sont d’origine animale. On considère qu’en moyenne cinq nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année, dont trois sont d’origine animale.
- 80 % des agents qui ont un potentiel d’utilisation bioterroriste sont des agents zoonotiques.
Source OMSA
En dehors de l’actuelle pandémie à coronavirus, les zoonoses affecteraient chaque année dans le monde 2,4 milliards d’humains et en feraient mourir 2,2 millions.
Certaines zoonoses, comme les salmonelloses, les leptospiroses, la rage, sont fréquentes et répandues dans la plupart des pays. D’autres, comme les arboviroses, la morve, la peste, sont plus rares, ou plus localisées géographiquement.
La gravité médicale des zoonoses est extrêmement variable : parfois bénignes (vaccine, maladie de Newcastle), parfois mortelles (rage), le plus souvent graves (brucellose, tuberculose, salmonelloses, leptospiroses, tularémie, listériose, fièvre Q, ornithose, rickettsioses, botulisme, fièvre charbonneuse, chikungunya, encéphalites virales, morve, dengue, Ebola).
Leur impact économique est très important pour l'élevage (tuberculose, brucellose) et pour les budgets de santé publique (influenza aviaire hautement pathogène H5N1, aujourd’hui Covid-19), d'autant que leur nombre, très élevé, ne cesse de croître.
Les plus fréquentes ou les plus graves sont qualifiées de zoonoses majeures, celles qui sont à la fois rares et bénignes, de zoonoses mineures.
Certaines comme la maladie de Lyme sont l’objet de controverses médiatisées. L’actualité médiatique met en avant à tel moment les listérioses, les salmonelloses, à tel autre moment les colibacilloses (à E. coli entéro-hémorragiques par exemple). La maladie de Creutzfeldt-Jakob atypique avait défrayé la chronique et créé des peurs amplifiées lors de la crise dite de la vache folle.
Les maladies zoonotiques émergent ou ré-émergent, même la peste humaine fait son retour !
Les barrières d’espèce paraissent de plus en plus souvent franchies.
La résistance des bactéries aux antibiotiques peut à certains égards être également considérée comme une zoonose et traitée comme telle.
Quand on veut attirer l’attention du public sur les règles d’hygiène à adopter avec les animaux de compagnie, on pointe du doigt la maladie des griffes du chat (lymphoréticulose bénigne d’inoculation, d’origine bactérienne), la toxoplasmose ou, s’agissant du chien, on évoque plus facilement les leptospiroses, la rage…
La lutte contre les zoonoses en médecine humaine
Elle n’a pour le moment rien de spécifique par rapport à la lutte contre toute maladie infectieuse humaine.
Chez l’homme, la première étape à franchir est celle du diagnostic, avant celle du traitement curatif et surtout celle de la prévention. Prévention par l’hygiène et la biosécurité, laquelle conduit souvent à la mise en place de plans de maîtrise collective, associés à l’éducation, le tout pouvant être complété et renforcé par la vaccination, encouragée ou obligatoire.
Les médecins doivent avoir à l’esprit que l’éradication, qui n’a pu être réalisée aujourd’hui dans le monde que pour un très petit nombre de maladies non zoonotiques devient pratiquement inenvisageable dans le cas des zoonoses.
La lutte contre les zoonoses en médecine vétérinaire
Elle passe évidemment, en amont de l’homme, pour les maladies dont la transmission se fait essentiellement des animaux à l’homme, par des actions de la médecine vétérinaire lorsque la maladie est en situation de s’exprimer chez les animaux domestiques, qu’il s’agisse de traitement ou de prévention.
Dans ces domaines, la médecine vétérinaire se veut avant tout préventive. Cela est dans sa culture. Elle privilégie toujours la santé publique avec deux exemples : la tuberculose, l’influenza aviaire hautement pathogène.
La détection précoce des maladies et infections à leur source animale peut empêcher leur transmission aux humains ou l’introduction d’agents pathogènes dans la chaîne alimentaire.
La population animale concernée, dès lors qu’elle est considérée comme réservoir, est contrôlée (tests de diagnostic) ; les animaux malades sont isolés, mis en quarantaine.
Des lots d’animaux, des élevages entiers peuvent dans certains cas être volontairement détruits (influenza aviaire hautement pathogène, médiatiquement connu sous le nom de grippe aviaire). Des vides sanitaires sont institués, accompagnés de désinsectisations, désinfections…
Les plans de maîtrise, dans une approche populationnelle, ont une faveur pour les méthodes instituant des barrières sanitaires et celles qui font appel à l’hygiène renforcée.
La faveur est aussi à l’éducation des propriétaires d’animaux à de bons comportements dans leur relation et leur interaction avec les animaux, notamment avec ceux au statut sanitaire incertain ou bien malades.
Des procédures de travail sont élaborées, visant à garantir la protection des personnes en contact direct ou indirect avec les animaux.
La maîtrise de ces maladies peut faire appel aussi à la prévention médicale par la vaccination, notamment la vaccination obligatoire.
En plus de ces différentes mesures, et notamment quand les espèces en cause ne sont pas des espèces domestiques, la prévention passe par une information des personnes et par la formation quant à la façon de se protéger (hygiène, protection collective et individuelle). Elle doit sans doute passer aussi par une réglementation coercitive.
Dans le cas de la Covid-19, comme antérieurement dans le cas du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) ou dans celui du MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient), il faut espérer que les leçons de l’origine soient clairement tirées et que, dans les pays d’origine, non seulement certains marchés soient définitivement interdits mais que les comportements humains dans la relation aux animaux (mode de vie, alimentation) soient assez radicalement modifiés.
Agir auprès de la source animale pour préserver la santé humaine
Les maladies d’origine animale auxquelles l’homme est sensible telles que l’influenza aviaire, la rage, la fièvre de la vallée du Rift ou encore la brucellose, représentent des risques mondiaux de santé publique.
D’autres maladies à transmission essentiellement interhumaine circulent chez l’animal ou ont un réservoir animal identifié et peuvent causer de graves crises sanitaires comme l’a récemment démontré l’épidémie de la maladie à virus Ebola.
Ces risques s’accentuent avec la mondialisation, le changement climatique ainsi que les modifications de comportements humains qui offrent de nombreuses opportunités aux pathogènes de coloniser des territoires inhabituels et d’évoluer sous de nouvelles formes.
Le contrôle dès leur source animale, de tous les pathogènes zoonotiques, c’est-à-dire transmissibles de l’animal à l’homme et vice versa, est la solution la plus efficace et la plus économique pour protéger l’homme. Par conséquent, la protection de la santé publique doit passer par l’élaboration de stratégies mondiales de prévention et de contrôle des pathogènes, coordonnées à l’interface homme-animal-écosystèmes et applicables aux échelles mondiale, régionale et nationale grâce à la mise en place de politiques adaptées.
Les médecins doivent désormais se questionner au-delà des seuls diagnostic, traitement et prévention des maladies infectieuses et les vétérinaires ne doivent pas se limiter aux infections animales seules susceptibles de s’exprimer par des pathologies animales.
Il convient à l’évidence de changer de stratégie. Il faut lutter contre les maladies plutôt que contre les agents de ces maladies. En tout état de cause, la lutte doit se focaliser autour de l’agent pathogène à sa source animale.
C’est ce que dit et répète le Professeur Didier SICARD, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, relayant le discours de l’OMSA sur le concept d’Une seule santé.
Le concept d'Une seule santé ou One Health
Le concept d’Une seule santé (One Health) est un concept maintenant bien acquis par les services vétérinaires. Il est présenté sur le site de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Le concept "Une seule santé" a été introduit au début des années 2000, synthétisant en quelques mots une notion connue depuis plus d'un siècle, à savoir que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent.
L’OMSA envisage et met en œuvre ce concept comme une approche collaborative globale pour appréhender dans leur ensemble les risques pour la santé humaine, animale – qu’elle concerne les animaux domestiques ou sauvages - et des écosystèmes.
Elle met à profit non seulement les normes intergouvernementales qu’elle publie et l’information mondiale sur la santé animale qu’elle recueille, mais également son réseau d’experts internationaux et ses programmes de renforcement des services vétérinaires nationaux.
En outre, l’OMSA collabore de manière synergique avec plus de 70 autres organisations internationales, notamment celles qui jouent un rôle clé dans l’interface homme-animal-écosystèmes.
Evolution historique du concept d’Une seule santé
Au XIXe siècle la recherche sur les maladies humaines et animales se faisait de concert (Pasteur, Virchow). Au XXe siècle, les routes sont progressivement devenues parallèles, sans passerelles.
En France les rigidités persistent, même au début des années 2000. La crise sanitaire de la covid-19 l’a parfaitement démontré : par exemple il a fallu attendre plusieurs mois de fonctionnement du Conseil scientifique Covid-19 pour qu’un vétérinaire (un seul) y soit nommé…
Cependant au XXIe siècle, devant le constat de l’émergence des maladies, des zoonoses notamment, depuis 2004, la Wildlife Conservation Society a promu le concept de One Health (Une seule santé).
Ainsi donc ce concept émerge, même s’il existait factuellement plus d’un siècle plus tôt, sans être ni nommé ni jamais mis en œuvre par les décideurs. La conscience écologique ajoute un élément important : la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquelles elles coexistent.
Le lancement fin 2020 au niveau international, sous impulsion française du "Haut Conseil Une seule santé" - conseil scientifique de haut niveau -, est assurément une initiative dont on peut se réjouir.
Une seule santé, c’est une approche unifiée, systémique et intégrée de la santé des humains et des animaux
Il s’agit, pour protéger l’homme, de protéger les animaux ; les mesures de contrôle les plus efficaces étant à l’évidence celles qui touchent les sources.
Il faut :
- détecter les maladies à la source et précocement ;
- impliquer davantage les vétérinaires, notamment dans la faune sauvage ;
- que les stratégies de contrôle des pathogènes soient coordonnées à l’interface homme-animal-écosystèmes ;
- au-delà des espèces animales, raisonner sur l’ensemble du vivant.
Il convient de faire tomber partout les cloisonnements. Une seule santé représente un exemple frappant de la nécessaire solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Cela nécessite aussi d’associer bien plus en amont les deux médecines, humaine et vétérinaire : au niveau de la recherche, de l’enseignement, des académies, des agences…
La médecine ne peut plus se passer des mathématiques, ainsi que de sciences telles que la physique, l’écologie, la zoologie, l’entomologie, l’intelligence artificielle, la géomatique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication… Il va falloir, au-delà des études épidémiologiques, mettre en place des systèmes d’alerte d’événements anormaux.
Lutter contre les trafics, aboutir à l’interdiction des marchés d’animaux vivants et la consommation d’espèces sauvages font partie de préoccupations devenues impérieuses. Il faudra sans doute aussi limiter et contrôler les nouveaux animaux de compagnie.
Il faut éduquer toujours plus, en particulier à l’hygiène mais aussi au respect des animaux et du vivant en général. Au respect de la vie, tout simplement.
Garantir partout des services vétérinaires compétents pour un monde plus sûr
Les Services vétérinaires nationaux jouent un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de gestion des risques sanitaires. En protégeant la santé et le bien-être animal, ils contribuent à améliorer la santé humaine à proprement parler, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments et plus globalement la sécurité alimentaire.
Il leur est donc nécessaire de disposer de moyens appropriés pour prévenir et contrôler les maladies animales de manière efficace, et pouvoir communiquer et travailler en lien étroit avec de nombreux acteurs, afin d’agir de manière concertée.
Comme le martèle depuis des années avec insistance l’OMSA, cela passe par la mise en place et l’action effective et efficace de services vétérinaires organisés et puissants dans tous les pays du monde.
En conclusion...
Le slogan de l’OMSA "Protéger les animaux, préserver notre avenir" est une façon de décliner et de promouvoir le concept One Health, Une seule santé.
Raisonner et agir sur la planète à l’échelle de tout le vivant permettra d’aller plus loin, dans une approche de santé publique humaine, animale et environnementale interdépendante.
D’ores et déjà il y a lieu de considérer la santé animale comme un bien public mondial.