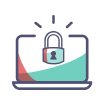Quelle information ?
L’information des patients doit porter sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles qui sont inhérents à des actes d’investigation, de traitement, ou de prévention.
Elle peut être délivrée oralement au cours d’un entretien individuel.
Quelle preuve ?
La preuve incombe au praticien et est, en théorie, libre mais les juridictions civiles ou disciplinaires sont de plus en plus exigeantes.
Cela fait longtemps que la fiche de consentement éclairé standardisée signée de la main du patient ne suffit plus à démontrer la teneur du colloque singulier entre le professionnel de santé et son patient.
De la même manière, la photocopie de l’agenda du professionnel de santé montrant plusieurs rendez-vous pré opératoires ne suffit pas à démontrer ce qui a été dit au cours des consultations.
Les juridictions peuvent admettre un faisceau d’indices regroupant un courrier dicté en présence du patient, des dessins ou schémas et croquis explicatifs mais rien ne remplace la fiche établie par les différentes sociétés savantes qui sont spécifiques à l’intervention pratiquée.
La date de la signature ne doit pas être trop proche du jour de l’opération afin de montrer que le patient a pu bénéficier d’un délai de réflexion suffisant.
Quelles responsabilités ?
La responsabilité du praticien peut être de deux ordres :
- une responsabilité civile visant à réparer le préjudice subi,
- une responsabilité disciplinaire visant à sanctionner le praticien.
Dans certains cas spécifiques (recherche biomédicale) il peut même y avoir une poursuite pénale.
Au plan civil : la notion de perte de chance ou le préjudice dit "d’impréparation"
La perte de chance peut être constituée quand les juges vont considérer que le patient mal informé, victime d’un accident médical non-fautif, a perdu une chance de se soustraire à l’intervention s’il avait pu bénéficier d’une information complète sur le risque qui est survenu.
Aussi, le praticien pourra être exonéré de toute responsabilité s’il parvient à démontrer que le patient, même bien informé, ne se serait pas soustrait à l’intervention.
Cette démonstration peut se faire de deux manières :
- en démontrant le caractère vital ou indispensable de l’intervention,
- en démontrant que la volonté du patient était telle que même bien informé, il ne s’y serait pas soustrait.
Tentant compte de ces éléments, les experts judiciaires ou, plus souvent, les juges vont évaluer un taux de perte de chance.
Plus l’intervention était nécessaire ou plus le patient était demandeur de cette intervention, plus le taux de perte de chance sera bas. Inversement, si l’intervention est dite de confort ou à visée esthétique, le taux de perte de chance sera d’autant plus haut.
L’indemnisation se fait donc par l’application du taux de perte de chance retenu par les juges au montant du préjudice corporel.
Outre cette perte de chance, la jurisprudence a créé un poste de préjudice autonome exclusivement lié à ce défaut d’information : le préjudice moral d’impréparation psychologique.
Il s’agit ici d’indemniser les répercussions psychologiques liées à la survenue du dommage auquel le patient ne s’était pas préparé.
Ce préjudice s’indemnise de manière forfaitaire et son montant et oscille entre 3 000 et 5 000 euros selon les juridictions.
La Cour de cassation considère que ces deux préjudices (la perte de chance et le préjudice d'impréparation) sont distincts et peuvent dès lors être cumulativement indemnisés lorsqu'ils sont tous deux caractérisés.
Pour conclure...
Le manquement à l’obligation d’information peut engendrer des conséquences importantes.
Il peut coûter des dizaines de milliers d’euros aux assureurs mais également aux praticiens qui peuvent être privés d’exercer leur activité pendant plusieurs mois.
À retenir...
Ces conséquences pourraient être facilement évitées :
- en prenant le soin de faire signer à chaque patient un document d’information détaillé et adapté à l’intervention ou aux soins dont il bénéficie ;
- en laissant au patient un délai de réflexion suffisant (si la situation le permet) afin qu’il puisse consentir de manière libre et éclairée.
Intégrée au Code de déontologie et consacrée par la loi du 4 mars 2002, dite "Loi Kouchner", l'obligation d'information figure également dans les différents codes de déontologie des professionnels de santé.




.png)