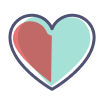Comprendre la disponibilité sur demande des fonctionnaires hospitaliers
-
Qu’est-ce que la disponibilité sous réserve des nécessités de service ?
Cette disponibilité peut être demandée pour plusieurs motifs.
Pour études ou recherches présentant un intérêt général
La disponibilité est accordée :
- pour une durée ne pouvant excéder 3 ans,
- renouvelable une fois pour une durée égale.
Pour convenances personnelles
La durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années.
Elle est renouvelable :
- dans la limite d'une durée maximale de 10 ans pour l'ensemble de la carrière,
- à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de 5 ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
Par ailleurs, le fonctionnaire qui sollicite une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, et qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de 4 années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Pour exercer une activité dans un organisme international
La disponibilité est accordée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L.5141-1, L.5141-2 et L.5141-5 du code du travail
Cette mise en disponibilité ne peut excéder 2 ans.
Elle n'est pas renouvelable.
Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles.
Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de 4 années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Le fonctionnaire en disponibilité sous réserve des nécessités de service conserve-t-il son droit à l’avancement ?
Le décret 2019-234 du 27 mars 2019 a prévu 5 exceptions à la règle qui veut que le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Ainsi, le fonctionnaire placé en disponibilité dans les 5 cas suivants et qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans :
- Pour convenances personnelles.
- Pour exercer une activité dans un organisme international.
- Pour créer ou reprendre une entreprise.
- Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteints d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.
L'activité professionnelle visée par ce texte recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
- Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an.
- Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cas d’une disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, aucune condition de revenu n'est exigée.
La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle et la quotité de temps travaillé (activité salariée), ou les revenus générés (activité indépendante) au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.
Qu'est-ce que la disponibilité de droit ?
La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire pour une durée de 3 ans renouvelable, si les conditions pour l'obtenir sont réunies :
- pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans ;
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire pour se rendre dans les DOM-TOM ou à l'étranger en vue d'adopter un ou plusieurs enfants à condition d'être titulaire de l'agrément d'une durée de six semaines prévu par le code de l'action sociale et des familles.
Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément.
Comment faire une demande de disponibilité ?
Toute disponibilité, qu'elle soit de droit ou accordée sous réserve des nécessités de service, doit faire l'objet d'une demande écrite de la part du fonctionnaire. La demande doit mentionner :
- la date à laquelle le fonctionnaire souhaite bénéficier de cette mise en disponibilité,
- la durée sollicitée,
- le motif.
La décision appartient au directeur de l'établissement.
La demande de disponibilité peut-elle être refusée ?
- S'agissant des disponibilités de droit, l'administration ne peut opposer aucun refus à la demande de l'agent.
- Pour les disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service, l'administration peut refuser ou différer le départ en disponibilité tant que les nécessités de service l'imposent.
Un silence de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord de l'administration (Article L511-3 du Code général de la fonction publique).
En cas d'acceptation de la disponibilité, l'administration peut exiger de l'agent qu'il effectue un préavis de trois mois maximum (article 14 bis de la loi n° 83-634).
Quelle rémunération pendant une disponibilité ?
L'agent en disponibilité ne perçoit aucune rémunération.
Durant cette période, il cesse également de bénéficier de ses droits à l'avancement (sous réserve des exceptions mentionnées plus haut) et à la retraite.
Est-il possible de travailler pendant une période de disponibilité ?
Le fonctionnaire placé en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité. Ainsi, un fonctionnaire ayant par exemple sollicité une disponibilité pour élever son enfant de moins de 12 ans ou donner des soins à un proche doit pouvoir justifier à tout moment que sa période de disponibilité est effectivement utilisée à ces fins.
Par conséquent, le droit d'exercer une activité professionnelle dépendra du type de disponibilité sollicité.
En ce qui concerne la disponibilité pour convenances personnelles ou celle obtenue pour suivre son conjoint, aucune disposition n'interdit à l'agent public d'exercer une activité lucrative durant cette période.
Le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 prévoit les modalités d’autorisation.
Modalités de la demande
Le fonctionnaire qui sollicite une disponibilité (ou son renouvellement) et qui souhaite exercer une activité professionnelle lucrative durant cette période, doit :
- en informer son administration par écrit,
- avant le début de l'exercice de son activité privée,
- en transmettant toutes les informations utiles sur le projet d’activité envisagé.
Tout changement d'activité pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
La réponse de l’administration
La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
Si un doute subsiste sur la compatibilité du projet avec les obligations précitées, l’autorité hiérarchique saisi le référent déontologue. En dernier recours, si le doute demeure, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie. Seule cette dernière saisine suspend le délai de 2 mois dans lequel l’administration doit formuler une réponse à l’agent à compter de la réception de celle-ci.
En effet, il a été jugé qu'une infirmière bénéficiant d'une disponibilité pour élever son enfant de moins de 8 ans pouvait, dans la mesure où elle était mère célibataire, cumuler cette disponibilité et un travail réduit. Cette tolérance étant admise car le bénéfice d'un temps partiel n'avait pu être permis dans son établissement. (Tribunal administratif).
Un tribunal administratif a également pu valider une activité d'assistante maternelle, l'agent public ayant un enfant en bas âge.
Quelles démarches à l’issue de la période de disponibilité ?
Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter :
- soit le renouvellement de sa disponibilité,
- soit sa réintégration.
Que se passe-t-il en l’absence de demande de renouvellement ou de réintégration ?
Faute de demande de réintégration ou de prolongation de la disponibilité, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.
Quelles sont les modalités de réintégration ?
Plusieurs situations peuvent se présenter :
- La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé 3 ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.
- Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que 3 postes lui aient été proposés.
- Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit :
- reclassé,
- placé en disponibilité d'office,
- en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite,
- s'il n'a pas droit à pension,
- licencié.
.png) À NOTER
À NOTER
Dès lors que le poste n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il doit être regardé comme vacant (CE, 24 janvier 1990, requête n° 67078).
Des allocations chômage peuvent-elles être perçues en l’absence de réintégration ?
La circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public permet la perception d’allocations chômage sous certaines conditions.
L'agent qui sollicite sa réintégration de manière anticipée ou au terme de sa disponibilité et qui se voit opposer un refus de réintégration par son administration, faute de poste vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de la réglementation de l'assurance chômage. Cette situation ouvre droit à la perception d'allocations chômage. |
Depuis 1992, le Conseil d’État reconnaît aux fonctionnaires ayant demandé leur réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, le droit de percevoir les allocations chômage lorsque cette réintégration est refusée par l’administration d’origine (CE n° 108610 du 10 juin 1992 Bureau d’aide sociale de Paris c/Mme H., CE n° 216912 du 30 septembre 2002).
Les intéressés doivent en effet être regardés comme des "travailleurs involontairement privés d’emploi" au sens de la réglementation de l’assurance chômage, et notamment de l’article L.5421-1 du code du travail (ancien article L.351-1), rendu applicable aux fonctionnaires de l’État par l’article L.5424-1 (ancien article L.351-12) du même code.
De plus, un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été :
- non seulement involontairement privé d'emploi,
- mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L.5421-1 du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance (CE, 30 septembre 2002, req. 216912 ).
La haute juridiction a étendu le bénéfice du droit à l’indemnisation au chômage au cas d’un fonctionnaire qui demande sa réintégration dans son administration d’origine avant l’arrivée du terme normal de sa disponibilité, et qui ne peut bénéficier de cette réintégration faute d’emploi vacant (Conseil d’État du 14 octobre 2005, Hôpitaux de Saint Denis, req. n° 248705).
Pour mémoire, dès lors que l’emploi n’est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, le poste doit être regardé comme vacant et l’agent est en droit d’être réintégré sur ce poste.
Un report de la disponibilité est-il possible en cas de maladie ?
Il résulte de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que l’octroi d’un congé pour maladie est de droit dès lors que les conditions posées à son attribution sont remplies.
Le Tribunal administratif de Toulouse, (18 juillet 2016, n° 1305474 et 1400138) a ainsi jugé que l’agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander de rester en position d’activité jusqu’à la date d’expiration du congé maladie.
La solution adoptée par le Tribunal administratif est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État qui, pour des faits similaires, a pu décider que l’employeur public ne peut légalement refuser de reporter la date de mise en disponibilité de l’agent public jusqu’à la date d’expiration de la période pendant laquelle ce dernier est en droit de bénéficier d’un congé de maladie (CE, 24 janvier 1992, n° 90516).