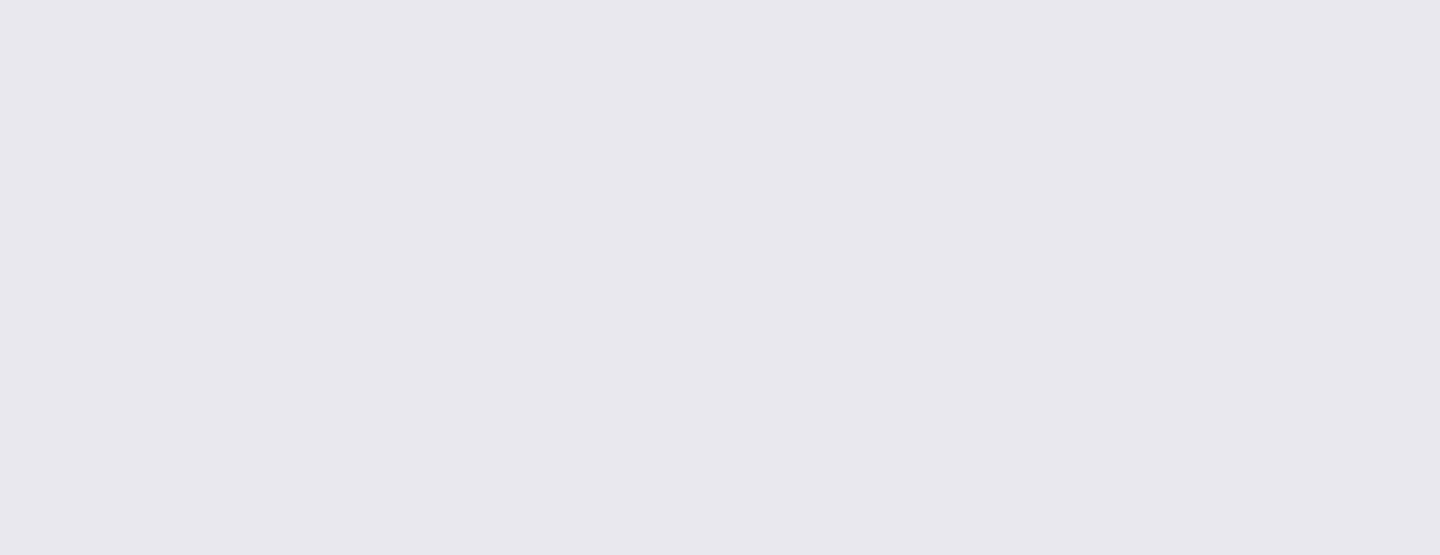Les chiffres clés des décisions civiles
- En diminution de 16 % par rapport à 2022
- 70 % de ces décisions sont défavorables, taux stable depuis plusieurs années
- 588 professionnels de santé ont été mis en cause, y compris les établissements de santé
59 % d’entre eux ont été condamnés - 38 mises en cause de l’ONIAM
- 8 mises en cause de parties "autres" (fabricants, employeurs, laboratoires, etc.)
- 61 963 959 € de condamnations ont été prononcées par les juridictions
Focus médecins
Médecins : quelles sont les spécialités les plus mises en cause ?
On retrouve dans le Top 10 des spécialités les plus mises en cause :
- La chirurgie : 114 mis en cause
- La médecine générale : 81
- L’anesthésie réanimation : 40
- L’hépato-gastro-entérologie : 23
- Le radiodiagnostic et l’imagerie médicale : 22
- L’ophtalmologie : 20
- La cardiologie : 16
- La médecine d’urgence : 14
- La gynécologie obstétrique : 11
- La pédiatrie : 10
Les spécialités dans le trio de tête sont les mêmes depuis plusieurs années.
Au-delà de la 10e place, on retrouve :
- La psychiatrie - La stomatologie : 9 mis en cause chacune
- La gynécologie médicale - L’anatomie et cytologie pathologique : 7 chacune
- L’urologie : 5
- La dermatologie : 4
- La radiothérapie - La pneumologie - La rhumatologie - L’oncologie - L’angiologie - La néphrologie - La médecine interne : 2 chacune
- L’endocrinologie - Les laboratoires d’analyse médicale - La médecine physique et de réadaptation - La génétique médicale - La gériatrie - La pharmacie : 1 chacun.
Focus sur la chirurgie
Au sein de la catégorie "chirurgie", le trio de tête est constitué de :
- La chirurgie orthopédique et traumatologique : 46 mis en cause
- La chirurgie maxillo-faciale : 17. Concerne cette année quasi-exclusivement des interventions portant sur la sphère ORL
- La neurochirurgie : 13
Au-delà de la 3e place, on retrouve :
- La chirurgie viscérale et digestive : 12
- La chirurgie générale : 9
- La chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique : 8
- La chirurgie thoracique et cardio vasculaire - La chirurgie vasculaire : 3 chacune
- La chirurgie ORL - La chirurgie urologique - La chirurgie gynéco obstétricale : 1 chacune.
Médecins : quelles sont les spécialités les plus condamnées ?
Le taux global de médecins condamnés se maintient à un niveau comparable aux années précédentes. Il atteint 55 % en 2023, contre 56 % en 2022.
La situation est cependant contrastée selon les spécialités : ainsi, les chirurgiens représentent 30 % de l’ensemble des médecins condamnés et ils l’ont été à 69 % en 2023, soit un taux plus élevé qu’en 2022.
Nous ne nous intéresserons ici qu’aux spécialités qui enregistrent un nombre significatif de mises en cause. En effet, les taux de condamnation sur des volumes faibles ne permettent pas de dégager des tendances pertinentes pour la spécialité concernée.
Les 10 spécialités les plus condamnées sont :
- La chirurgie : 79 condamnés
- La médecine générale : 37
- L’anesthésie réanimation : 21
- Le radiodiagnostic et l’imagerie médicale : 14 chacun
- L’hépato-gastro-entérologie 12
- L’ophtalmologie : 11
- La cardiologie : 11
- La médecine d’urgence : 6
- La gynécologie obstétrique : 6
- La pédiatrie : 6
Quels sont les taux de condamnation des 5 spécialités médicales les plus mises en cause en 2023 ?
Les 5 spécialités les plus mises en cause en 2023 enregistrent toutes, sans exception, des taux de condamnation élevés.
Le taux de condamnation des chirurgiens et des anesthésistes excède 50 % depuis plusieurs années. Pour les autres spécialités, la situation est plus contrastée d’une année à l’autre.
Spécialité | Taux de condamnation |
|---|---|
| Chirurgie | 69 % |
| Médecine générale | 46 % |
| Anesthésie réanimation | 53 % |
| Radiodiagnostic et imagerie médicale | 64 % |
| Hépato-gastro-entérologie | 52 % |
Focus non-médecins
En 2023, 7 catégories de professionnels non-médecins ont été mises en cause, contre 5 en 2022.
Profession | Mis en cause | Condamnés | Taux de condamnation |
|---|---|---|---|
| Chirurgien-dentiste | 79 | 58 | 73 % |
| Masseur-kinésithérapeute | 6 | 2 | 33 % |
| Sage-femme | 1 | 0 | 0 % |
| Vétérinaire | 2 | 1 | 50 % |
| Infirmier(e) | 6 | 6 | 100 % |
| Pédicure podologue | 1 | 1 | 100 % |
| Psychologue | 1 | 0 | 0 % |
Les chirurgiens-dentistes représentent, comme tous les ans, l’immense majorité des non-médecins mis en cause (81 %). Ils enregistrent cette année un taux de condamnation de 73 %, en hausse de 6 points par rapport à 2022 mais qui reste relativement stable sur les 5 dernières années.
Les taux de condamnation des autres professions sont moins significatifs en raison du faible volume de mises en cause.
Cette année, on note un nombre plus élevé qu’à l’accoutumée de mises en cause d’infirmiers. Elles concernent une seule et même affaire, avec une prise en charge critiquable, par plusieurs infirmières, d’une cicatrice désunie après une intervention. Elles ont toutes abouti à des condamnations.
Focus indemnisations civiles
Quel est le montant global d’indemnisations civiles en 2023 ?
En 2023, 61 963 959 € ont été alloués aux victimes par les juridictions civiles.
Ce montant est en très nette augmentation (+ 34 %) par rapport à 2022, alors pourtant que le nombre de décisions civiles est, lui, en diminution. Cela s’explique par le fait que :
- La plus forte indemnisation de 2023 atteint le record de 15 787 113 €. À elle seule, elle a pesé pour 1/4 sur le total des indemnisations de l’année.
- Si, globalement, le taux de condamnation des professionnels de santé est resté stable, il est en augmentation pour les spécialités dans lesquelles les volumes de mises en cause sont importants.
En cas de procédure en réparation du préjudice, les organismes sociaux doivent obligatoirement être informés afin de faire valoir leur créance concernant les dépenses de santé engagées par la victime. Ainsi, en 2023, il a été versé 11 433 721 € aux organismes sociaux, soit 18 % du montant des indemnisations prononcées.
Quel sont les montants d’indemnisations civiles pour les médecins ?
Les 10 spécialités ayant donné lieu au règlement des plus fortes indemnisations en 2023 sont les suivantes :
- Chirurgie : 12 465 k€
- Gynécologie obstétrique : 9 640 k€
- Médecine générale : 6 785 k€
- Pédiatrie : 4 859 k€
- Anatomie et cytologie pathologique : 1 654 k€
- Anesthésie réanimation : 1 381 k€
- Radiodiagnostic et imagerie médicale : 1 320 k€
- Cardiologie : 931 k€
- Ophtalmologie : 745 k€
- Hépato-gastro-entérologie : 711 k€
Logiquement, la chirurgie et la médecine générale figurent dans le Top 3 des plus fortes indemnisations, puisqu’il s’agit des spécialités les plus mises en cause et les plus condamnées. La gynécologie obstétrique y figure également, non en raison du volume de mises en cause mais plutôt de la nature du préjudice qui, dans cette spécialité, peut être particulièrement lourd (par exemple, l’infirmité motrice cérébrale d’un enfant).
La part des indemnités mises à la charge de ces 3 spécialités en tête du classement représente, à elle seule, 70 % du montant total des indemnités allouées aux victimes par les juridictions civiles en 2023.
Les autres spécialités ont donné lieu à des indemnisations moindres :
- Médecine d’urgence : 439 k€
- Stomatologie : 138 k€
- Urologie : 124 k€
- Gynécologie médicale : 89 k€
- Psychiatrie : 74 k€
- Radiothérapie : 38 k€
- Oncologie : 19 k€
- Gériatrie : 17 k€
- Médecine physique et de réadaptation : 14 k€
- Dermatologie : 8 k€
- Laboratoire d’analyses médicales : 6 k€
- Pharmacie : 6 k€
- Néphrologie : 2 k€
Focus sur la chirurgie
Dans la catégorie "chirurgie", c’est la chirurgie orthopédique qui arrive en tête, ce qui est logique au regard du nombre de mises en cause et du taux élevé de condamnation dans cette spécialité. Elle ravit très largement la place, cette année, à la neurochirurgie qui n’arrive qu’en seconde position.
- Chirurgie orthopédique et traumatologique : 4 979 k€
- Neurochirurgie : 2 937 k€
- Chirurgie viscérale et digestive : 2 185 k€
- Chirurgie maxillo-faciale : 1 297 k€
- Chirurgie générale : 395 k€
- Chirurgie vasculaire : 366 k€
- Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique : 211 k€
- Chirurgie urologique : 56 k€
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire : 37 k€
Quels sont les montants d’indemnisations civiles pour les non-médecins ?
- 1 101 k€ pour les chirurgiens-dentistes, qui assument toujours la plus grande part de la charge chez les non-médecins puisqu’ils font l’objet du plus grand nombre de mises en cause et ont un taux de condamnation élevé. Cette charge n’est pas représentative du poids financier global de leur sinistralité, car leurs litiges se résolvent majoritairement à l’amiable, par transaction, non évoquées ici.
- 61 k€ pour les infirmiers, qui ont été davantage mis en cause cette année et condamnés dans 100 % des cas.
- 28 k€ pour les masseurs-kinésithérapeutes
- 22 k€ pour les pédicures podologues
- 1 k€ pour les vétérinaires
Comment les indemnisations se répartissent-elles par tranches ?
En 2023, 74 décisions ont donné lieu à des condamnations supérieures à 100 000 €, soit presque le même nombre qu’en 2022 (76).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Entre 100 000 et 300 000 € | 40 | 42 | 52 | 35 |
| Entre 300 000 et 500 000 € | 6 | 12 | 10 | 12 |
| Entre 500 000 et 1 000 000 € | 7 | 13 | 5 | 19 |
| Entre 1 000 000 et 2 000 000 € | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Entre 2 000 000 et 3 000 000 € | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Entre 3 000 000 et 4 000 000 € | 0 | 1 | 0 | 0 |
| + de 4 000 000 € | 0 | 1 | 2 | 1 |
En 2023, les sinistres ayant des montants supérieurs à 100 000 € ont concerné 13 spécialités, contre 16 en 2022.
Quelles sont les 10 indemnisations les plus élevées ?
Nous vous présentons ici plus en détail les 10 plus fortes indemnisations de l’année 2023.
Prise en charge tardive d’une asphyxie fœtale
Une parturiente est admise au sein d’une clinique en vue de son accouchement. Le lendemain, elle donne naissance à son enfant qui a été victime de bradycardie avec souffrance fœtale importante pendant le travail, entraînant des lésions cérébrales.
La responsabilité a été tranchée en 2008. La clinique et le gynécologue obstétricien ont été reconnus responsables à parts égales du dommage subi par l’enfant. En 2023, les juges statuent sur l’évaluation des préjudices de la victime et rejettent notamment les demandes concernant la prise en charge des thérapies à l’étranger ainsi que le remboursement de l’achat d’une maison, en considérant qu’il n’est pas démontré que l’aménagement du logement antérieur était insuffisant.
Prise en charge inadaptée d’une infection néonatale à l’origine de lourdes séquelles
Une femme ayant présenté un streptocoque en cours de grossesse accouche d’un enfant qui, à deux jours de vie, présente une infection urinaire et une anémie. Une antibiothérapie est donc mise en place par deux médecins pédiatres. L’enfant est admis en réanimation néonatale alors qu’il présente une méningite d’origine bactérienne, conséquence d’une transmission par sa mère du colibacille lors de l’accouchement. Il garde d’importantes séquelles.
La responsabilité a été tranchée en 2009. Les juges ont retenu la responsabilité totale des deux pédiatres en leur reprochant de ne pas avoir donné les soins appropriés à l’enfant suite à son infection néo-natale. En 2023, le préjudice est liquidé. La plus grande partie est constituée de l’indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent.
Prescription médicale inadaptée à l’origine d’un syndrome de Lyell
Un médecin généraliste prescrit du SPIFEN 400 à une patiente présentant une infection des voies aériennes supérieures. Devant l’aggravation de l’éruption cutanée devenant prurigineuse, la patiente se rend aux urgences. Un syndrome de Lyell est alors diagnostiqué.
Il est reproché au médecin traitant d’avoir prescrit du SPIREN 400 alors qu’une allergie à l’aspirine était notée dans le dossier médical et qu’une telle prescription n’était pas recommandée en cas de rhinite allergique ou de bronchite. Le lien entre la survenue du syndrome de Lyell et la prise du médicament est donc établi. La responsabilité exclusive du praticien est retenue, il doit intégralement réparer les préjudices.
Amputation à la suite d’une infection nosocomiale
Un patient bénéficie d’une intervention chirurgicale du genou droit au sein d’une clinique. Les suites sont marquées par des complications et notamment un choc septique justifiant une nouvelle opération. De nombreux soins sont ensuite délivrés au patient, qui subit également de nouveaux gestes chirurgicaux dont l’un consiste en une amputation sous forme de désarticulation du membre opéré.
L’infection streptococcique du site opératoire, ayant évolué vers une fasciite nécrosante à streptocoque A, est qualifiée de nosocomiale en l’état d’une survenue moins de 24 heures après l’intervention chirurgicale et en l’absence de cause étrangère mise en évidence. Les responsabilités du chirurgien pour défaut de surveillance et du laboratoire pour transmission tardive des résultats d’analyse sont retenues.
Prise en charge fautive d’un nouveau-né à l’origine de troubles neurologiques
Devant une diminution des mouvements actifs du fœtus, une femme enceinte est admise en clinique. Le rythme cardiaque fœtal est alors contrôlé par un gynécologue obstétricien. À la naissance, l’enfant présente une hypotrophie et de l’hypoglycémie, justifiant la prise de sérum glucosé et un contrôle de sa glycémie. Il présente aujourd’hui un retard de développement et notamment une tétra parésie spastique, une atteinte axiale, des troubles neurologiques et des complications musculaires.
Des manquements sont relevés à l’encontre du gynécologue obstétricien et de la clinique dans la prise en charge de l’enfant après sa naissance : retard de diagnostic et insuffisance de la prise en charge de l’hypoglycémie, faute dans la surveillance échographique fœtale. Le taux de perte de chance de l’enfant de ne pas subir les séquelles neurologiques et autres complications est alors évalué à 70% par les juges. L’état de la victime n’étant pas consolidé, les préjudices de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et le préjudice scolaire et de formation seront indemnisés ultérieurement.
Absence d’échographie anténatale et prise en charge inadaptée d’un nouveau-né à l’origine de complications
Au cours de sa grossesse, une femme réalise une échographie mettant en évidence un placenta recouvrant le col. À la suite de saignements importants, l’intéressée est admise au sein d’une clinique où lui sont prescrites une tocolyse intra-veineuse et deux cures de corticothérapie afin d’accélérer la maturation pulmonaire du fœtus. Devant la persistance des saignements, une césarienne est décidée mais la parturiente accouche avant qu’elle ne soit réalisée. L'état anémique et hypoxique de l’enfant est immédiatement constaté, il est alors pris en charge par un pédiatre.
La responsabilité de la clinique est retenue puisqu’aucune échographie n'a été réalisée pendant l'hospitalisation de la mère, alors même que la grossesse était à risque. Ce manquement a empêché la réalisation d'une césarienne en urgence, qui aurait pu limiter les différents préjudices. La responsabilité du pédiatre est également engagée pour ne pas avoir pris la tension artérielle du nouveau-né et organisé son transfert afin qu’il bénéficie d’une prise en charge de sa pathologie plus adaptée.
Prise en charge peropératoire fautive aggravant les séquelles de l’aléa thérapeutique initial
Après une chirurgie sinusienne, une réintervention est réalisée par un chirurgien ORL en raison de céphalées persistantes. Lors du geste chirurgical, une brèche dure-mérienne se produit mais passe initialement inaperçue. Par la suite, le diagnostic d’empyème sous-dural est posé et le patient est transféré en urgence pour bénéficier d’une neurochirurgie. Il présente désormais une hémiplégie droite complète avec aphasie.
Un accident médical non fautif, constitué par la fracture osseuse et la brèche méningée, est retenu ainsi qu’une faute du chirurgien dans la prise en charge peropératoire. Les experts considèrent qu’une imagerie aurait probablement montré les lésions anormales et ainsi permis de poser le diagnostic d’extension infectieuse intracérébrale. Les séquelles neurologiques, considérées comme inévitables à la suite de l’accident médical, ont été majorées par le manquement fautif.
Prise en charge non conforme à l’origine d’une paraplégie
À l’issue d’une IRM montrant une compression de la moelle dorsale, un patient bénéficie d’un éveinage saphène gauche avec phlébectomies et quitte le centre chirurgical sans que le scanner préconisé ne soit réalisé. Devant une claudication neurogène majeure, une nouvelle intervention chirurgicale est réalisée mais interrompue devant la découverte d’une hernie discale calcifiée nécessitant alors une autre approche chirurgicale. Après avoir découvert une paraplégie complète, tant sur le plan sensitif que moteur, un complément de laminectomie T8T9 et une évacuation de l’hématome compressif sont réalisés. Une rééducation est organisée dans les suites.
Il est reproché au neurochirurgien différents manquements. Tout d’abord, les experts estiment que l’indication d’hémi laminectomie gauche n’était pas conforme aux données acquises de la science, car dangereuse sur le plan fonctionnel. Ensuite, l’erreur dans la lecture de l’IRM, l’absence de scanner en préopératoire et de bilan neurophysiologique sont relevées. Le chirurgien est donc reconnu entièrement responsable des dommages subis par le patient.
Retard de diagnostic à l’origine d’une paraplégie
Dans un contexte de douleurs envahissantes, un patient bénéficie de consultations avec son médecin traitant, un radiologue, un médecin ostéopathe et un pneumologue et plusieurs examens sont réalisés. Malgré cette prise en charge, le diagnostic de lymphome B n’est posé que tardivement. Le patient présente désormais une paraplégie due à une compression médullaire avec déplacement de la moëlle à droite.
La constitution progressive du tableau clinique et l’association de plusieurs signes auraient dû alerter le médecin généraliste traitant sur l’existence d’une pathologie grave. Un défaut d’information est retenu à l’égard du radiologue. Par ailleurs, le comportement du médecin ostéopathe est considéré comme fautif en l’absence d’examen neurologique préalable à la manipulation et de toute exploration complémentaire. Le taux de perte de chance est fixé à 75%.
Prise en charge tardive d’un mélanome due à une interprétation erronée de résultats d’analyse
En 2011, un patient bénéficie de l’exérèse d’un naevus. Le laboratoire d’anatomie pathologique où il est envoyé conclut à l’absence de malignité. En 2013, ce patient est pris en charge pour une grosseur axillaire. La métastase d’un mélanome malin est mise en évidence. La lame du naevus retiré en 2011 est de nouveau observée et un aspect de mélanome malin naevocytoïde est retrouvé. Le patient est décédé après avoir suivi une chimiothérapie et une radiothérapie.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre du dermatologue au motif qu’il n’est pas de sa responsabilité de remettre en cause le rapport des anatomopathologistes. Ces derniers ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ce qu’ils auraient pu conclure à un naevus atypique et ainsi préconiser une surveillance. Les juges retiennent un taux de perte de chance de 92% d’éviter le décès.
À noter
L’ONIAM peut, lui aussi, être condamné à des sommes très importantes. Ainsi, en 2023, il a été condamné, au titre de l’aléa thérapeutique, à indemniser à hauteur de 1 125 945 € une patiente atteinte de graves troubles sensitivomoteurs touchant les membres inférieurs et d’un syndrome de la queue de cheval, à la suite d’une opération pour canal lombaire étroit.