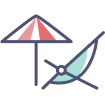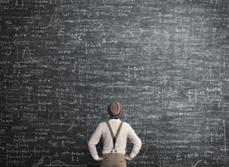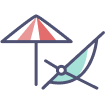Les différents régimes obligatoires, même cumulés, ne suffisent pas à compenser la perte de revenus qui accompagne le départ à la retraite.
Pour faire un bilan retraite gratuit avec l'aide d'un conseiller MACSF, n'hésitez pas à nous solliciter :
Système de retraite : en bref
Le système de retraite français, qui fonctionne par répartition, est basé sur la solidarité entre les générations. Cela signifie que les actifs ne cotisent pas pour leur pension future, mais pour celle des retraités actuels.
Les conditions de départ à la retraite
Pour partir à la retraite à taux plein, c’est-à-dire avec l’intégralité de la pension à laquelle vous pouvez prétendre, vous devez remplir deux conditions :
- avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
- avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaire.
Le nombre de trimestres à cumuler dépend de votre année de naissance, mais également de votre statut d’indépendant, de fonctionnaire ou de salarié du secteur privé.
Il varie ainsi de 166 trimestres pour les personnes nées entre 1955 et 1957 à 172 trimestres pour toutes celles nées à partir de 1973.
Un âge de départ relevé à 64 ans
La réforme des retraites publiée au Journal Officiel du 15 avril, qui doit entrer en vigueur en septembre 2023, prévoit un relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Comment se compose une retraite ?
Tout au long de leur carrière et selon leur statut, les actifs cotisent pour préparer leur retraite auprès de deux, voire trois régimes :
- un régime de base,
- un régime complémentaire,
- un régime sur-complémentaire, obligatoire pour les professionnels de santé conventionnés.
S’y ajoute le régime dit « supplémentaire », qui désigne les solutions d’épargne retraite individuelles ou d’entreprises souscrites à titre facultatif.
La retraite de base
La plupart des régimes de base tiennent compte de la rémunération sur laquelle vous avez cotisé et du nombre de trimestres validés.
La retraite de base des professions libérales a la particularité d’être un régime « par points ». Cela signifie que, tout au long de votre carrière, vos cotisations sont d’abord converties en points retraite. Ces points sont ensuite convertis en pension au moment de votre départ en retraite.
Retraite de base : qui paie qui ?
Statut professionnel | Organisme verseur |
Professions libérales | Le CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) |
Salariés du privé (hors statuts particuliers) | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale MSA (Mutuelle sociale agricole) pour les salariés agricoles |
Artisans, commerçants & industriels | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
Salariés du public (fonctionnaires d’État) | Le SRE (Service des retraites de l'État) |
| Salariés du public (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) | La CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) |
Contractuels du public | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
Travailleurs indépendants | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
Artistes-auteurs | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
La retraite complémentaire
Tous les régimes de retraite complémentaires sont des régimes de retraite par points. Les points que vous cumulez en cotisant sont convertis en pension de retraite au terme de votre carrière. Naturellement, plus vous totalisez de points et plus le montant de votre pension est élevé.
Retraite complémentaire : qui paie qui ?
Statut professionnel | Organisme verseur |
Professions libérales | Le CNAVPL à travers l’une de ses 10 sections professionnelles |
Salariés du privé (hors statuts particuliers) | Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) |
Artisans, commerçants & industriels | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
Salariés du public (fonctionnaires d’État) | RAFP (Retraite additionnelle de la fonction publique) |
| Salariés du public (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) | RAFP (Retraite additionnelle de la fonction publique) |
Contractuels du public | Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) |
Travailleurs indépendants | Assurance retraite – Régime général de la Sécurité sociale |
Artistes-auteurs | IRCEC Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs |
La retraite sur-complémentaire
Les professionnels de santé conventionnés, tels que les médecins ou les chirurgiens-dentistes, doivent cotiser auprès d’un troisième régime, appelé PCV (Prestations complémentaires vieillesse). Leurs cotisations sont partiellement prises en charge par l’assurance maladie, au titre de la convention passée avec la Sécurité sociale.
On distingue ce régime, obligatoire, des retraites supplémentaires désignant les régimes facultatifs par capitalisation. On retrouve parmi ceux-là :
- les régimes proposés à leurs salariés par certaines entreprises,
- les produits d’épargne retraite individuels.
Vous êtes professionnel de santé libéral ?
Pour préparer au mieux votre passage à la retraite, la MACSF vous explique comment s’articulent vos retraites de base, complémentaire et supplémentaire.
À la retraite, une baisse de revenus à anticiper et à compenser
Quels que soient les régimes de retraite auprès desquels vous cotisez et le mode de calcul appliqué à vos futures pensions, le passage de la vie active à la retraite se traduit toujours par une baisse des revenus.
Ce rapport entre la pension de retraite et le dernier revenu d’activité perçu est appelé « taux de remplacement ». En 2020, ce taux était en moyenne de 75% en France, avec des écarts très importants selon les niveaux de rémunération et les statuts professionnels.
Les acteurs de la santé comptent parmi les professionnels dont le taux de remplacement est le plus faible. L’écart entre leurs revenus d’activité et leur pension de retraite peut ainsi atteindre 66% dans le cas d’un professionnel de santé libéral.
Quelques chiffres parlants
- 1/3 : en tant que professionnel de santé exerçant en libéral, vous percevrez en moyenne 1/3 de vos revenus actuels une fois à la retraite*.
- 36% : c’est le pourcentage de votre revenu actuel que vous toucherez une fois à la retraite** si vous êtes praticien hospitalier.
- 1 393€ par mois : c’est la pension de retraite moyenne en France, en tenant compte des prélèvements sociaux.
* Source : étude COR-Retraites. Exemple pour un médecin avec une carrière de 35 ans.
** Source : étude COR-Retraites. Exemple pour un praticien hospitalier (13e échelon + ISPE) âgé de 30 ans en 2009 avec un départ à la retraite à 65 ans. Taux de remplacement en projection à 2044 : 36 % (base + complémentaire + ASV).
Ces exemples concrets donnent une idée plus précise de l’évolution à la baisse de vos revenus à la retraite, au terme de votre carrière. Dans le cadre du système de retraite actuel, seule une retraite supplémentaire par capitalisation permet de compenser cette perte.
Chaque situation étant unique, n’hésitez pas à évaluer le montant que vous percevrez à la retraite grâce à notre simulateur retraite.
Quelle retraite pour les praticiens hospitaliers ?
Pour les professionnels de santé exerçant leur activité à l’hôpital, le passage à la retraite s’accompagne d’une forte baisse de revenus. La MACSF vous conseille sur la meilleure façon d’y faire face en préparant dès à présent votre après-carrière.
Maintenir ses revenus grâce à l’épargne retraite individuelle
Chaque parcours professionnel étant différent, il est important de préparer votre retraite de manière individuelle, en tenant compte de votre métier, de votre rémunération, mais aussi de votre statut.
En effet, chaque régime de retraite applique son propre mode de calcul de pension. Et il peut être différent d’une caisse de retraite à l’autre ! Heureusement, différentes options s’offrent à vous pour assurer, en fonction de vos besoins spécifiques, le maintien de tout ou partie de vos revenus au terme de votre activité professionnelle.
Ouvert à tous, le PER (ou Plan d'épargne retraite) permet, par exemple, de mettre de l’argent de côté en cours de carrière afin d’obtenir, à la retraite, une rente et/ou un capital. Il se décline en contrats individuels ou d’entreprise. Commercialisé depuis fin 2019, le PER individuel remplace le plan d'épargne retraite populaire (PERP) et les contrats Madelin.