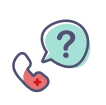L’infirmier peut-il retirer les dispositifs médicaux d’un patient décédé, tant que le certificat de décès n’a pas été établi ?
L'infirmier ou l'infirmière est habilitée à pratiquer les actes définis aux articles R4311-7 et R4311-9 du Code de la santé publique "soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin".
Les actes d'ablation de matériel et de dispositifs médicaux font partie de ceux qui doivent être réalisés sur prescription écrite du médecin, le texte n'opérant aucune distinction selon que le patient est vivant ou non.
Même si le patient est décédé, il n'y a aucune urgence à s'empresser d'enlever les dispositifs médicaux dont il est porteur.
À l'inverse, l'ablation intempestive des dispositifs médicaux nécessaires "à la protection, au maintien et à la restauration de la santé du patient" peut être lourde de conséquences.
S’il n'est pas approprié, dans ce contexte, d'attendre une "prescription médicale", il convient en revanche d'attendre son équivalent : le constat de décès officiel et écrit du médecin, pour procéder au débranchement des appareils.
En cas de difficulté pour obtenir ce certificat dans des délais raisonnables, la rédaction de protocoles pour le décès d'un patient, en concertation avec la Direction de l'établissement, le personnel médical et paramédical, prévoyant une procédure répondant d'une part aux exigences réglementaires et d'autre part aux nécessités du service, peut permettre de clarifier la situation.
Quel est le protocole pour le décès d'un patient porteur d’un stimulateur cardiaque ?
"Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière.
Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes.
Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation.
A cet effet, le médecin chargé de constater le décès signale la présence ou non d’une prothèse sur les trois volets administratifs du certificat de décès destinés respectivement :
- à la mairie du lieu de décès,
- à celle du lieu d’implantation de la chambre funéraire,
- au gestionnaire de la chambre funéraire où sera déposé le corps".
Article R.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 3
En quoi consiste le protocole de l'inventaire des biens pour le décès d'un patient ?
"En cas de décès, les objets appartenant à la personne hébergée font l’objet d’un dépôt. Ses proches en sont avisés. Un document leur est remis pour les inviter à procéder au retrait des objets".
Article R.1113-6 du CSP
En quoi consiste la toilette mortuaire ?
La toilette mortuaire est un geste de continuité du soin réalisé par les agents du service de soins (IDE, AS) et parfois par des agents dédiés à la chambre mortuaire, selon les établissements.
Elle consiste :
- à fermer les yeux et la bouche du patient,
- à effectuer une toilette et un change complets,
- à retirer les matériels invasifs (perfusions, sondes) et les pansements.
Certaines religions proscrivent totalement ce protocole de toilette en cas de décès. Il est donc important de s’abstenir en cas de doute, ou de prendre contact rapidement avec la famille.
L’objectif est de restaurer la dignité du patient afin de donner une image plus "présentable" à la famille et aux proches.
Aucun rite, notamment religieux, n’est pratiqué à cette occasion. Ceux-ci sont plutôt réservés à la chambre mortuaire, et surtout à la chambre funéraire.
Combien de temps le corps peut-il demeurer dans la chambre ?
"Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R2223-76."
Article R.2223-93 du CGCT
Ce délai, qui n'est justifié par aucune considération scientifique, peut être réduit, ce que font certains établissements dans leurs protocoles, parfois jusqu’à deux heures.
En tout état de cause, il faut tenir compte de chaque cas particulier en étudiant le contexte.
- Il est évident qu'une personne décédée en chambre double doit être transférée le plus rapidement possible en chambre mortuaire.
- Il doit aussi être tenu compte des conditions climatiques : en période de canicule, il peut être déraisonnable d'attendre au-delà de deux heures.
Quelles sont les différences entre chambre mortuaire et chambre funéraire ?
- La chambre funéraire (régie à l'article L2223-38 CGCT) constitue l'un des éléments du service extérieur des pompes funèbres.
- La chambre mortuaire (régie à l'article L2223-39 CGCT), qui existe dans les établissements de santé, n'est pas soumise à la procédure d'habilitation imposée aux chambres funéraires.
Le régime de l'admission est différent dans les deux chambres.
- Les établissements ayant constaté plus de 200 décès par an (en moyenne sur les trois dernières années) sont soumis à l’obligation de disposer d’une chambre mortuaire (article R2223-90 du code général des collectivités territoriales), parfois appelée amphithéâtre, morgue ou dépositoire, dans laquelle le patient décédé est transporté et où il peut séjourner jusqu’à trois jours, sans facturation possible pour la famille. Au-delà, le séjour peut être facturé mais c’est une pratique qui reste rare.
- Les autres établissements ont recours à la coopération hospitalière, qui permet le transfert dans un établissement disposant de la structure nécessaire. Mais souvent, c’est à la famille d’organiser rapidement – dans les dix heures suivant le décès – le transfert du corps. À défaut, c’est au chef d’établissement de se charger de ce protocole en cas de décès du patient.
Crédit photo : CALMETTES / BSIP