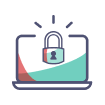L'exercice exclusif de la téléconsultation
La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) de donner une consultation à distance à un patient (Article R 6316-1 du CSP).
Afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, il importe que cette technique demeure secondaire, accessoire à l’exercice de la médecine en présentiel.
Ainsi le médecin téléconsultant ne peut-il ni prendre en charge un patient exclusivement en téléconsultation ni exercer son activité exclusivement en téléconsultation.
La prise en charge d’un patient exclusivement en téléconsultation
Le médecin doit dispenser à ses patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et "élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés" (Articles R 4127-32 et R 4127-33 du CSP).
Le recours à la téléconsultation relève de la seule décision du médecin, qui doit juger de la pertinence d’une prise en charge médicale à distance plutôt qu'en présentiel.
Ainsi, dès lors qu’il estime qu’un examen clinique est souhaitable, le médecin doit proposer une consultation en présentiel à son patient.
Par ailleurs, le CNOM rappelle son attachement au principe de territorialité, de proximité des soins, gage de la qualité et de la continuité de la prise en charge des patients :
"Si le médecin téléconsultant n’exerce pas en présentiel dans le même territoire que le patient, la méconnaissance de la réalité du terrain par le médecin posera difficulté.
Il ne peut donc être accepté qu’un médecin prenne en charge un patient :
- sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médicosocial,
- sans se préoccuper de son parcours de soins,
- sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée."
La pratique exclusive de la téléconsultation par le médecin
Ce mode de consultation à distance est également susceptible d’engendrer une perte d’expérience clinique et une situation d’insuffisance professionnelle du médecin qui y aurait recours de manière exclusive.
C’est donc toujours dans un souci de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients que l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie prévoit que l’exercice de la télémédecine par un médecin conventionné ne peut dépasser plus de 20 % de son volume d’activité globale conventionnée à distance sur une année civile.
Pour les médecins non conventionnés (ex : médecins hospitaliers, salariés…), la part d’activité en télémédecine doit également rester minoritaire.
Il importe donc que les médecins continuent à consacrer la majeure part de leur activité aux consultations en présentiel.
Il ressort du rapport du CNOM que la majorité des médecins ayant une activité de téléconsultation exclusive exercent au sein de plateformes commerciales. Se pose donc la question du caractère déontologique ou non de telles plateformes.
L’usage d’une plateforme commerciale pour exercer une activité de téléconsultation
Cette question se pose d’autant plus que ces plateformes commerciales (ou du moins certaines d’entre elles) soulèvent d’autres difficultés.
Une médecine en dehors de toute organisation territoriale et de tout parcours de soins
En effet, nous parlons ici de plateformes qui prévoient un système de mise en relation numérique quasi instantanée, éphémère et non personnalisée entre un patient et un praticien pouvant se trouver à n’importe quel endroit du territoire national et n’ayant jamais vu ce patient en présentiel.
Ces structures ne respectent donc ni le principe de subsidiarité de la téléconsultation (par rapport à l’exercice en présentiel), ni le parcours de soins coordonné, ni le principe de territorialité et de proximité des soins.
En cela, elles contreviennent non seulement aux règles permettant la prise en charge des téléconsultations par l’Assurance maladie mais également et avant tout à celles édictées par le Code de déontologie médicale.
Le CNOM rappelle que l’exercice de leur activité par l’intermédiaire de telles plateformes n’exonère pas les médecins de leurs obligations déontologiques.
Les médecins doivent donc :
- demander aux sociétés commerciales de s’inscrire dans le cadre d’organisations territoriales référencées ;
- indiquer leur lieu d’exercice présentiel et leurs coordonnées pour éclairer le choix des patients et faciliter le suivi de leur prise en charge.
Des pratiques tendant à faire considérer la médecine comme un commerce
Par ailleurs, la plupart de ces plateformes commerciales se présentent en "offreurs de soins" au moyen de campagnes nationales d’information et de promotion sur les réseaux sociaux ou dans les médias.
Cela tend à faire considérer la médecine comme un (e-)commerce.
Or les règles de la déontologie médicale interdisent l’exercice de la médecine comme un commerce et toute forme de publicité à caractère commercial (Articles 19 et 20 du Code de déontologie médicale).
En outre, de telles pratiques peuvent être qualifiées d’actes de concurrence déloyale (et sanctionnées comme telles) à l’égard de la profession dès lors qu’elles procurent aux médecins exerçant via ces plateformes commerciales un avantage interdit aux autres médecins, qui exercent la télémédecine dans le cadre territorial et dans le respect du parcours de soins.
Si la plateforme commerciale encourt des sanctions, le CNOM rappelle que les médecins participant à l’offre de téléconsultations proposée par cette plateforme sont, eux aussi, susceptibles de poursuites disciplinaires sur la base des articles 19 et 20 du Code de déontologie médicale.
L’instauration d’une obligation de règlement des honoraires avant la téléconsultation
Certaines plateformes commerciales contreviennent encore aux règles déontologiques en ce qu’elles subordonnent l’accès à la téléconsultation au prélèvement du montant de la consultation à distance, alors même que le patient n’a pas encore été mis en relation avec le médecin.
D’autres plateformes conditionnent l’accès à la téléconsultation à un abonnement préalable du patient à la plateforme, et ce, à un tarif qui ne fait pas toujours l’objet d’une information claire et précise.
Or, aux termes de la réglementation, le médecin ne peut facturer au patient que les frais correspondant aux "actes réellement effectués", et ce, "même s’ils relèvent de la télémédecine" (Article R 4127-53 du CSP).
De plus, il est tenu de délivrer une information claire, honnête et précise sur ses honoraires.
Le paiement des honoraires à la société commerciale et non au médecin lui-même
Dans certains cas, la rémunération du professionnel de santé est facturée et perçue non par celui-ci mais par la société commerciale.
Dans un jugement rendu au mois de novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu l’occasion de rappeler qu’une société commerciale comportant un tel système de facturation ne respectait ni le principe du paiement direct des honoraires par le patient au médecin ni, par conséquent, les principes de liberté d’exercice et d’indépendance professionnelle et morale des médecins.
Le traitement des données de santé à caractère personnel et la question du respect du secret médical
Enfin, les données de santé du patient recueillies avant, pendant ou après la téléconsultation sont des données sensibles qui doivent faire l’objet d’un hébergement chez un hébergeur certifié ou agréé (Article L 1111-8 du CSP).
La plateforme commerciale doit informer les médecins qui exercent leur activité par son intermédiaire de l’identité et des coordonnées de l’hébergeur de données de santé et leur transmettre une attestation de cet hébergeur.
Car il appartient aux médecins de s’assurer du respect de la législation en la matière.
Dans le cas contraire, en cas de litige, ils ne pourraient se retrancher derrière la simple affirmation par la société commerciale que celle-ci a recours à un hébergeur de données de santé certifié. Leur responsabilité pourrait être engagée pour non-respect du secret médical.
En outre, la plateforme commerciale doit informer les patients de l’existence et des modalités d’exercice de leur droit d’opposition au partage et à l’échange de leurs données de santé.
Il en résulte, par exemple, que les conditions générales d’utilisation auxquelles doivent adhérer les patients avant de demander une téléconsultation ne peuvent prévoir que toute téléconsultation donne automatiquement au médecin qui l’a effectuée la qualité de membre de l’équipe de soins.
Le CNOM rappelle d’ailleurs que "les interventions ponctuelles en téléconsultation de différents médecins, sollicités par un même patient, qu’ils ne connaissent pas, sans ancrage territorial, et sans lien avec d’autres médecins ou professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge, ne saurait caractériser l’existence d’une équipe de soins".
Voici donc les risques de mésusage de la téléconsultation mis en exergue par le CNOM et susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire, mais également civile et/ou pénale du médecin téléconsultant.