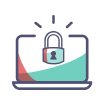Deux mineures vaccinées contre le papillomavirus humain sans l’accord de leur père
Une pédiatre administre à deux jeunes filles mineures de 12 et 13 ans, amenées en consultation par leur mère, un vaccin contre le papillomavirus humain.
Peu de temps après, le père des deux jeunes filles, qui était opposé à cette vaccination et reproche à la pédiatre de ne pas avoir cherché à recueillir son accord, dépose une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins. Sa plainte ayant été rejetée, il fait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre, qui annule la décision de première instance et inflige un blâme à la pédiatre. Il est retenu un manquement aux obligations déontologiques imposées par l’article R.4127-42 du Code de la santé publique selon lequel le consentement des deux parents doit être recherché.
La pédiatre se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le principe : la recherche du consentement parental varie selon le caractère, usuel ou non, de l’acte
En matière de soins sur mineur, le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale doit être recherché, ainsi que celui du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Sur la question de la nécessité du consentement des deux parents, l’article 372-2 du Code civil pose le principe qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Qu'est-ce qu'un acte usuel ?
On considère généralement que constituent des actes usuels ceux relevant de la vie courante, sans gravité particulière : maladies infantiles ordinaires, soins pour des blessures sans gravité, mais aussi les vaccinations obligatoires.
Qu'est-ce qu'un acte non usuels ?
A l’inverse, on considère comme des actes non usuels ceux relevant d’une certaine gravité, tels qu’une hospitalisation prolongée, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les traitements lourds, ou chroniques, ou impliquant d’importants effets secondaires.
Une vaccination non obligatoire : acte usuel ou acte non usuel ?
La chambre disciplinaire nationale a assimilé la vaccination en cause, non obligatoire, à un acte non usuel. Elle a donc considéré que recueillir le consentement des deux parents était nécessaire, sans s’interroger sur l’absence ou non de risque pouvant résulter de cette vaccination.
Ce raisonnement est critiqué par le Conseil d’Etat : "En ne relevant aucun autre élément se rapportant à la nature de la vaccination en cause, aux caractéristiques des patientes concernées ou à l’ensemble des circonstances dont Mme D...-F (la pédiatre) avait connaissance, pour juger que celle-ci ne pouvait considérer de bonne foi que la mère des deux jeunes filles était réputée agir avec l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit".
En l’espèce, il appartenait à la chambre disciplinaire de rechercher cet ensemble d’éléments et, seulement dans un second temps, d’en déduire si la pédiatre pouvait, en toute bonne foi, considérer que l’accord du père n’était pas nécessaire.
Sa décision est donc annulée.
Que retenir de cette affaire ?
Les vaccinations obligatoires sont considérées comme des actes usuels, sans doute du fait de leur caractère impératif qui réduit la marge d’appréciation des parents. Pour autant, et c’est ce que nous enseigne cette décision, une vaccination non obligatoire n’est pas systématiquement, a contrario, un acte non usuel.
Le caractère usuel ou non usuel va en fait dépendre, selon le Conseil d’État, du type de vaccination en cause, des caractéristiques du mineur concerné et, plus généralement, de l’ensemble des circonstances de fait et médicales entourant l’acte.
De telles nuances permettent de tenir compte de chaque situation, sans l’enfermer dans un raisonnement binaire entre obligatoire/non obligatoire et usuel/non usuel. S’il en résulte un certain flou, qui peut être source d’incertitude pour le praticien, c’est aussi une préservation de sa marge de manœuvre.
Dans le cadre particulier de la vaccination des mineurs de 5 à 11 ans contre la Covid-19, l'accord de l'un des deux parents suffit.