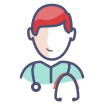Paralysie récurrentielle après une cure de névralgie cervico-brachiale
Il s’agit d’un homme de 64 ans qui consulte notre sociétaire pour une récidive de névralgie cervico-brachiale non déficitaire.
Il avait été opéré avec succès six ans auparavant d’une cure de hernie discale C5-C6.
Le tableau évoluant depuis douze mois malgré un traitement médical maximaliste (antalgiques de palier II, anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes, immobilisation), décision est prise de l’opérer. Il est proposé la mise en place d’une prothèse discale.
Un délai de réflexion est accordé, avec une deuxième consultation un mois plus tard pour formaliser la chirurgie. Dans l’intervalle, le dossier est validé en Staff.
Un consentement éclairé exhaustif est remis au patient et signé de sa part.
L’intervention se déroule sans difficulté.
Il est constaté en postopératoire immédiat une paralysie récurrentielle. Le chirurgien se veut rassurant et organise une prise en charge ORL.
L’évolution sera marquée par :
- une récupération incomplète de la paralysie récurrentielle avec une dysphonie résiduelle et des fausses-routes occasionnelles ;
- une sédation des douleurs radiculaires ;
- une aggravation des douleurs cervicales.
L’imagerie confirmera une prothèse parfaitement bien positionnée, une absence de décompensation des étages adjacents.
Notre sociétaire oriente alors son patient vers un Centre antidouleur en concluant "Je ne peux plus rien pour vous".
Un défaut d'information sur les alternatives thérapeutiques
Dans cette affaire, trois plaintes sont formulées à l’encontre du chirurgien :
- La survenue d’une paralysie récurrentielle.
- La persistance d’une cervicalgie résiduelle, attribuée à un mauvais choix thérapeutique, le patient se plaignant de l’absence de discussion entre une prothèse cervicale et une arthrodèse.
- L’absence de prise en charge de l’échec après orientation vers le Centre anti-douleur, avec un sentiment d’abandon.
L’Expert précisera que la paralysie récurrentielle constitue un accident médical non fautif, dont le taux de survenue est inférieur à 2 % et dont le patient avait parfaitement été informé.
Par contre, il retiendra un défaut d’information sur les alternatives thérapeutiques à la mise en place d’une prothèse discale.
Une alternative discutable d'un point de vue médical
Si le législateur exige légitimement des chirurgiens (comme des médecins) une information loyale et claire sur les risques et sur les alternatives des traitements qu’ils proposent, la question se pose parfois de savoir quelle compréhension les patients peuvent en avoir, et dans quelle mesure leur choix devient plus éclairé après l’information reçue.
Ainsi, dans le cas présent, il faut souligner que la question fait encore débat chez les chirurgiens du rachis et reste toujours d’actualité en symposium.
De plus, les publications mentionnent la non-infériorité du taux du succès global des prothèses discales par rapport à l’arthrodèse (HAS juin 2021).
Enfin, les études récentes confirment un taux de syndrome jonctionnel moins important lors de pose de prothèses discales vs arthrodèse.
Autrement dit, s’il avait été informé des possibilités d’une arthrodèse, au vu de ces éléments, le patient aurait donc raisonnablement opté pour une prothèse discale…
Que retenir sur le plan médico-légal ?
Il est dommage de risquer une condamnation pour un défaut d’information alors même que votre prise en charge a été diligente, attentive et exempte de critiques, sur le plan technique comme humain.
Le caractère exhaustif de l’information exigé par les magistrats ne permet donc pas de s’en dispenser.
—
Il impose même, au chirurgien comme au médecin, d’en conserver une preuve via une mention dans le dossier et/ou dans un courrier à son correspondant.
Enfin, il est parfois des phrases malheureuses, même si en apparence anodines, dont les conséquences peuvent cependant être lourdes, comme cela a été le cas dans ce dossier.
La démarche procédurière est parfois favorisée par un sentiment d’abandon de la part du patient lorsqu’il est adressé à un autre confrère.
Nous devons donc savoir passer la main mais néanmoins impérativement garder un contact avec nos patients en cas d’évolution défavorable.
Crédit photo : MENDIL / BSIP