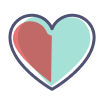Clause de non-concurrence des praticiens hospitaliers : quels sont les textes applicables ?
L'instauration d’une clause de non-concurrence est le fruit d’une longue évolution.
Une première tentative avec la loi HPST en 2009
La Loi HPST du 21 juillet 2009 a introduit dans le code de la santé publique un article L. 6152-5-1 censé permettre aux établissements de santé publics d’imposer aux praticiens hospitaliers démissionnaires une clause de non-concurrence. Cette clause devait leur interdire :
- l’ouverture d’un cabinet privé ;
- l’exercice d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie.
Cette faculté n’était ouverte qu’à l’encontre des praticiens hospitaliers :
- ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement ;
- si leur nouveau poste les mettait en concurrence directe avec l’établissement public.
Mais le décret supposé préciser cette disposition légale n’est jamais paru, ce qui l'a rendue inapplicable en l’état.
Une nouvelle initiative dans le décret du 30 janvier 2020
Le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, applicable à l'ensemble des agents publics et des praticiens, précise que l'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l'exercice de son activité privée.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.
Un nouveau dispositif de non-concurrence avec le décret du 5 février 2022
Désormais, le décret 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé encadre davantage l’exercice d’une activité privée lucrative pour les praticiens quittant leurs fonctions publiques.
Clause de non-concurrence : comment ça marche ?
La mise en œuvre d’une interdiction d’exercice n’est pas automatique.
Il s’agit d’une faculté offerte au directeur de l’établissement public, sous réserve que les conditions de cette mise en œuvre aient été portées à la connaissance de tous les praticiens concernés.
Ces conditions sont les suivantes :
Une information préalable et effective de chaque praticien
L’article R. 6152-827 du code de la santé publique énonce désormais que "la décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1, est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié".
Activités visées par une éventuelle non-concurrence
L’interdiction peut porter sur l’exercice d’une activité rémunérée dans :
- un établissement de santé privé à but lucratif,
- un cabinet libéral,
- un laboratoire de biologie médicale privé,
- une officine de pharmacie.
Procédure d'information du directeur d'établissement
Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions et qui envisage d'exercer l’une des activités visées en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal :
- par écrit,
- deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
Critères pris en compte pour interdire l'exercice au praticien hospitalier cessant ses fonction
L’interdiction d’exercice repose sur des critères cumulatifs :
- La quotité de travail du praticien au sein de l’établissement public de santé doit être au minimum de 50 % d’un temps plein ;
- L’interdiction est limitée à 24 mois et dans un rayon de 10 km autour de l’établissement public de santé dans lequel le praticien exerçait à titre principal.
Que se passe-t-il en cas de non-respect de l'interdiction d'exercice ?
- Lorsque le directeur d’établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction d’exercice, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec avis de réception.
- Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites et de se faire assister d'un défenseur de son choix.
- L’entretien se déroule en présence du président de la CME.
- Dans un délai d’un mois suivant la date de l'entretien, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité par lettre recommandée avec avis de réception.
- Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
- En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
La contestation de la clause de non-concurrence par le CNOM
À la suite de la publication du décret n° 2022-132 du 5 février 2022 modifiant le statut des personnels médicaux, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entendu contester deux dispositions relatives aux clauses de non-concurrence visant les praticiens hospitaliers.
Le Conseil national a en effet considéré que :
- non seulement les dispositions réglementaires accordaient aux directeurs d’établissement un pouvoir discrétionnaire ne permettant pas aux médecins de savoir pour quels motifs ils pourraient se voir interdire d’exercer une activité rémunérée ;
- mais encore que ces dispositions portaient atteinte à la liberté d’entreprendre et freinaient le développement des exercices mixtes ville/hôpital.
Le CNOM a donc saisi le Conseil d'État, lequel a estimé, dans deux décisions n°s 462977 et 462978 du 28 septembre 2022, que ces questions présentaient un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, a statué le 9 décembre 2022.
Il considère que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
- Il souligne que : "les dispositions contestées ont pour objet de réguler l'installation de praticiens à proximité des établissements publics de santé afin de préserver l'activité de ces établissements qui, en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, assurent le service public hospitalier. Le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
- L'interdiction d'exercice ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques.
- Cette interdiction ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé et, lorsqu'elle concerne un praticien qui cesse d'exercer ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
Dans la continuité de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat a, le 23 décembre 2023, rejeté la demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2022 déposée par le Conseil national de l’Ordre des médecins (Conseil d'État - 5ème chambre - 13 décembre 2023 , n° 462978)