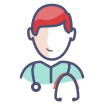Une fibrose pulmonaire fatale
Un patient est traité du 12 mars au 12 août 2009 pour une fibrillation auriculaire avec de l'Amiodarone prescrit par son cardiologue. Ce principe actif de la Cordarone® est utilisé dans la prévention et la correction des troubles du rythme cardiaque.
Il consulte par la suite un pneumologue en raison d'une hypoxie sévère et d’une pneumopathie interstitielle diffuse. Il est hospitalisé pour une dyspnée.
Une fibrose pulmonaire apparaît, son état se dégrade et il décède.
Ses ayants droit introduisent une procédure dirigée à l’encontre du laboratoire fabriquant l’Amiodarone et du cardiologue.
L’expert conclut que la fibrose est en lien direct et certain avec la prise de Cordarone®.
Les premiers juges retiennent la responsabilité du laboratoire ainsi que celle du prescripteur.
En appel, la Cour de Versailles confirme, le 25 novembre 2021, cette double condamnation.
Son analyse mérite d’être exposée.
Selon la Cour d’appel : un défaut du médicament et un défaut d’information
La Cour d’appel retient la responsabilité du laboratoire et du prescripteur.
Sur le défaut du médicament, caractérisé comme un produit défectueux
La première question qui se posait était de savoir si le médicament pouvait être caractérisé comme un produit défectueux.
Rappelons qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il convient dans cette appréciation de tenir compte de toutes les circonstances, et notamment :
- de la présentation du produit,
- de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu,
- du moment de sa mise en circulation.
À très juste titre, la Cour d’appel rappelle que le seul fait que le produit soit à l'origine du dommage ne suffit pas à présumer ou caractériser l'existence d'un défaut, un produit de santé comportant nécessairement des risques pour les patients.
Dans ces conditions, le défaut peut consister :
- en une information insuffisante sur les conditions de l'utilisation du produit, les indications ou les risques encourus par l'utilisateur ;
- une mauvaise appréciation du rapport bénéfice / risque du produit, évalué au regard de la gravité des effets nocifs constatés et de la fréquence de leur survenue.
La Cour d’appel donne raison au juge de première instance d’avoir considéré que l'information fournie dans la notice du médicament était insuffisante et ne satisfaisait pas à l'exigence de sécurité des produits de santé : en effet, il n'y était pas fait mention du risque de survenue d'une pneumopathie pouvant évoluer en fibrose pulmonaire. Tout au plus évoquait-elle des "problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux)" alors que le résumé des caractéristiques du produit (RCP) était, lui, beaucoup plus explicite. Il mentionnait en effet, au chapitre des effets indésirables :
- des manifestations pulmonaires,
- des cas de pneumopathies interstitielles et alvéolaires diffuses,
- des cas de bronchiolites oblitérantes organisées pouvant évoluer en fibrose pulmonaire.
Pour les magistrats, le patient n'a pas été mis en mesure de consentir de manière éclairée au traitement, en pleine connaissance des risques qui y étaient attachés.
Ce défaut d'information caractérise un défaut du produit engageant la responsabilité du fabricant.
—
Sur la responsabilité du cardiologue prescripteur
Les magistrats ne retiennent pas de faute technique, la prescription étant validée par l’expert. En revanche, c’est sur l’information déficiente qu’ils condamnent le médecin, en rappelant que c'est au prescripteur qu’ il revient de prouver qu'il a délivré une information complète à son patient.
En effet, aucun élément du dossier n’établit que le cardiologue a respecté cette obligation. Il avait pourtant accès à l'information selon laquelle la Cordarone® présentait un risque d'apparition de pneumopathie pouvant évoluer en fibrose pulmonaire dans la mesure où ce risque était mentionné dans le RCP et le Vidal.
Même à retenir, comme le faisait l'expert, qu'il s'agissait d'un risque exceptionnel, il présentait aux yeux des magistrats un caractère de gravité suffisant.
Le risque mortel existe en cas de fibrose pulmonaire et justifie à lui seul de délivrer l'information au patient.
—
La Cour d’appel décide de retenir à l’encontre du cardiologue deux préjudices en lien avec ce défaut d’information :
- celui résultant de la perte de chance d'éviter la réalisation du risque (qui sera évaluée à hauteur de 50 % de l’entier dommage) ;
- le préjudice moral résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité de développer une maladie pulmonaire potentiellement mortelle, évalué à la somme de 1 000 euros.
Avec une condamnation prononcée in solidum avec le laboratoire au titre de la perte de chance, c’est finalement le cardiologue qui doit supporter l’indemnisation la plus lourde.
La confirmation des responsabilités par la Cour de cassation
L’affaire a fait l’objet d’un pourvoi et la Cour de cassation s’est prononcée le 29 mars 2023. Elle confirme tant la condamnation du laboratoire que celle du cardiologue.
Sur la responsabilité du laboratoire
Le laboratoire tentait d’échapper à sa responsabilité en faisant valoir que la défectuosité de son produit n’était pas avérée : le producteur d’un médicament n’a pas l’obligation de reproduire à l’identique dans la notice le contenu du résumé des caractéristiques du produit, mais doit rédiger cette notice de manière claire et compréhensible.
Son argumentation reposait sur le fait que la notice du médicament pouvait être rédigée en termes différents du RCP.
En l’occurrence, il n'y était certes pas fait mention du risque de survenue d'une pneumopathie pouvant évoluer en fibrose pulmonaire, mais seulement de "troubles respiratoires (essoufflement, fièvre, toux)". Mais ces éléments traduisaient en langage courant le risque de manifestations pulmonaires comme la fibrose pulmonaire. Associés à la mise en garde expresse faite au patient en cas d’apparition "d'un essoufflement inhabituel, d'une toux, d'une fatigue ou d'une fièvre, prolongées ou inexpliquées", ils suffisaient à l’informer des risques encourus et à lui permettre d’agir de manière appropriée en cas d’effets indésirables.
La Cour de cassation rejette cet argument : la différence entre les mentions de la notice du médicament (accessible au patient) et le Vidal et le RCP (accessibles au prescripteur) caractérise une information insuffisante.
Le médicament est ainsi considéré comme n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, ce qui caractérise sa défectuosité.
Sur la responsabilité du cardiologue
De la même manière, la Cour de cassation confirme la condamnation du cardiologue au titre du manquement à son devoir d’information, tant pour le préjudice lié à la perte de chance que pour celui découlant de l’impossibilité à se préparer aux complications.
Que retenir de cette décision ?
Cette lourde condamnation rappelle l’absolue nécessité pour le médecin de respecter son devoir d’information qui, comme on le sait, débouche en cas de procédure sur un renversement de la charge de la preuve : il incombe au médecin de démontrer qu’il a bien informé son patient.
On peut se poser la question de savoir si le cardiologue aurait été condamné si la notice du médicament, incluse dans la boite, avait été exhaustive, ce qui laisserait à penser que l’information sur la iatrogénie repose quasi exclusivement sur le fabricant du médicament. Nous pensons que cela n’aurait rien changé à la décision, car le devoir d’information pèse sur le médecin.
Bien entendu, l’information qu’il doit délivrer et sa preuve sont beaucoup plus aisées lorsqu’il s’agit d’un acte technique (par exemple l’information sur le risque de perforation colique que doit délivrer un gastroentérologue avant de pratiquer une coloscopie) que pour une prescription médicamenteuse, a fortiori lorsque la notice du médicament présente des insuffisances !
Cette information doit être délivrée de façon orale. Cependant, le fait que la jurisprudence impose aux médecins, en cas de contestation, de rapporter la preuve de cette information doit les inciter à en établir une trace écrite et à la conserver dans le dossier médical.
Les commentaires du Dr Cédric Gaultier, Cardiologue conseil à la MACSF
Nous connaissons bien l'efficacité de l'Amiodarone dans les troubles du rythme auriculaire et ventriculaire et ses risques, qui font l’objet de plaintes (cf. "Amiodarone : revalidez vos prescriptions et informez vos patients !").
Il convient, avant tout :
- de toujours essayer d'autres molécules en première intention ;
- en cas d'échec, si le recours à l'Amiodarone reste bien entendu possible et parfois indispensable, de délivrer une information sur les risques parfois graves de cette molécule, et en particulier le risque pulmonaire (ainsi que le risque d'hyperthyroïdie, de neuropathie et du nerf optique). Cette information doit bien entendu être délivrée de façon orale. Puisque la jurisprudence impose aux médecins de prouver qu'ils ont délivré cette information, une trace écrite devient indispensable.
Cette traçabilité repose sur :
- une annotation dans le dossier,
- un courrier au médecin traitant,
- le compte rendu de consultation délivré au patient.
L’information doit également inviter le patient à signaler sans délai les signes d'alerte (dyspnée croissante, troubles neurologiques, ou visuels…), pour éventuellement en limiter les effets.
Cette logique s’applique aussi pour toutes les autres molécules à risques : anticoagulants, statines.
Enfin, il faut régulièrement valider l'indication à poursuivre les traitements prescrits (par exemple, pas d'indication à poursuivre l'Amiodarone lorsque la fibrillation reste permanente).