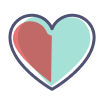Non-détection d’une trisomie 21 en anténatal
Dans le cadre du suivi de sa grossesse, une femme de 40 ans bénéficie de trois échographies :
- La première à 16 semaine d’aménorrhée (SA) à l’hôpital, mais dans le cadre d’une consultation en libéral.
- La seconde dans un cabinet de radiologie privé.
- La troisième à 34 SA, à l’hôpital où le suivi est assuré depuis la 27e SA.
Elle donne naissance à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d’une malformation cardiaque.
Les parents assignent l’hôpital devant le tribunal administratif, estimant qu’ils auraient dû être informés du risque de trisomie 21 et des examens possibles, notamment l’amniocentèse.
On rappelle en effet que lorsque des soins dispensés par un praticien hospitalier sont mis en cause, c’est le tribunal administratif qui est compétent, sauf hypothèse rare de la faute détachable.
En première instance comme en appel, les demandes des parents visant à obtenir la condamnation du centre hospitalier à une indemnité de 550 000 € en réparation des préjudices subis sont rejetées.
Les parents se pourvoient en cassation devant le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 13 novembre 2019, annule l’arrêt d’appel. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel qui, s’alignant sur l’arrêt du Conseil d’Etat, retient la responsabilité de l’hôpital par une décision du 29 septembre 2020.
Une information obligatoire sur les examens et leurs limites
Selon le I de l’article R.2131-2 du Code de la santé publique (CSP) :
Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l’article R.2122-1 ou, à défaut, au cours d’une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d’effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de l’article R.2131-1. / Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d’être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire.
En l’espèce, ce premier examen a eu lieu à l’hôpital, mais dans le cadre des consultations en secteur privé du praticien.
Comme en a jugé la Cour administrative d’appel, la responsabilité de l’établissement ne peut donc être recherchée à ce titre. Elle ne peut être appréciée qu’à compter de la date à laquelle la patiente a fait suivre sa grossesse dans l’établissement et notamment lors de la 3e échographie.
À cette période, la patiente n’avait reçu aucune information sur les examens possibles, dont l’amniocentèse, ni sur les options en fonction du résultat, et ce depuis le début de sa grossesse.
Même si la grossesse était alors à un stade avancé puisque la patiente a commencé son suivi à l’hôpital à 27 SA, il était toujours possible de l’informer de la possibilité de recourir à des examens complémentaires si cela n’avait pas été fait auparavant.
C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article R.2131-2-I du CSP qui fait état de la première consultation médicale ou, à défaut, "d’une autre consultation", par définition ultérieure.
Une amniocentèse était toujours possible
Selon l’article L.2213-1 du CSP :
L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
D’autre part, l’article L.2131-1-II du CSP énonce que :
Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse.
Que résulte-t-il de ces deux dispositions combinées ?
Lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de :
- vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L.2131-1 du CSP ;
- à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse puisqu’une interruption médicale de grossesse était toujours possible.
La Cour administrative d’appel considère que la faute commise a fait perdre aux parents une chance de l’ordre de 30% de faire réaliser une amniocentèse puis, éventuellement, de recourir à une interruption médicale de grossesse.
Le préjudice moral des parents est donc indemnisé à hauteur de 13 500 € chacun.