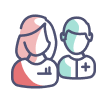Des produits qui "disparaissent" des stocks
Sans en avoir informé individuellement au préalable les salariés ni consulté les institutions représentatives du personnel, une pharmacie a mis en place un dispositif de vidéosurveillance.
Constatant des anomalies de stocks portant sur des lingettes et des biberons, le pharmacien visionne les enregistrements réalisés par ce système. Ce visionnage permet au pharmacien d’écarter l’hypothèse d’un vol par un client.
Les inventaires ayant confirmé des écarts de stocks importants, l’employeur suit alors les produits manquants lors de leurs passages en caisse et croise ces informations avec les séquences vidéo. Ce recoupement permet d’isoler les anomalies sur la caisse d’une seule salariée.
La salariée est alors licenciée pour faute grave. Elle conteste son licenciement devant le conseil des Prud’hommes, reprochant notamment à son employeur d’avoir recueilli des preuves en la mettant sous surveillance vidéo pendant 20 jours.
Vidéosurveillance : une preuve illicite si le salarié a été enregistré à son insu
Rappelons qu’en matière de vidéo surveillance, la jurisprudence de la Chambre sociale est constante :
Dès lors qu’un système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes est mis en place, il ne peut être utilisé pour surveiller les salariés qu’à condition que l’employeur informe son personnel et consulte les représentants du personnel.
À défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements du salarié est illicite.
Cassation sociale 10 novembre 2021 n° 20 12 263
Une décision de l’assemblée plénière en date du 22 Décembre 2023 a toutefois fait évoluer les règles en matière de droit de la preuve.
Elle a admis, sous certaines conditions, la production devant le juge civil d’éléments obtenus de manière déloyale.
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve n’est pas obligatoirement un motif de rejet, mais encore faut-il que le juge procède à différentes vérifications avant d’admettre la preuve litigieuse aux débats.
Il doit à la fois s’interroger :
- sur la légitimité du contrôle opéré ;
- sur l’existence de motifs concrets justifiant le recours à la surveillance ;
- sur le point de savoir si l’employeur ne pouvait obtenir la preuve visée par d’autres moyens ne portant pas atteinte aux droits personnels du salarié ;
- sur le caractère proportionné de l’atteinte à la vie personnelle du salarié et le but poursuivi.
Des enregistrements obtenus de manière illicite mais pourtant recevables
Dans l’affaire des enregistrements de vidéosurveillance dans la pharmacie, la salariée licenciée invoquait :
- l’illicéité de la preuve,
- l’existence de moyens de preuves plus respectueux de sa vie privée,
- le caractère disproportionné des moyens au regard du but poursuivi.
En première instance et en appel, ces demandes sont rejetées, les enregistrements étant considérés comme recevables.
La Cour d’appel motive sa décision en indiquant que le visionnage des enregistrements a été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks et à la suite de premières recherches infructueuses.
Par ailleurs, ce visionnage a été effectué par une seule personne : le dirigeant de l’entreprise.
La salariée se pourvoi en cassation.
Dans sa décision du 14 Février 2024 (n° 22- 23.073 F B), la Chambre sociale de la Cour de cassation fait une application des principes dégagés par l’assemblée plénière.
Elle estime que la Cour d’appel a correctement "mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de l’employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte du but légitime qui était poursuivi par l’entreprise ; la protection de ses biens".
La Cour d’appel a pu valablement décider que la production des données personnelles issues de la vidéo surveillance était "indispensable et proportionnée au but poursuivi et rendait recevables les preuves obtenues."
En application de l’évolution de la jurisprudence, les enregistrements tirés de la vidéosurveillance sont retenus et fondent le licenciement disciplinaire de la salariée. Le pourvoi de la salariée est logiquement rejeté par la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Cette décision s’inscrit donc pleinement dans le cadre d’une construction jurisprudentielle en cours sur la recevabilité d’une preuve illicite.
—





.png)