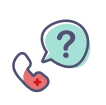Collègue atteint d'une addiction : dénoncer, ou ne pas dénoncer ?
Il n’existe aucun texte qui oblige un professionnel de santé à dénoncer un confrère qu’il pense être en situation d’addiction, qu’il s’agisse d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants.
Il ne pourra donc, en soi, être reproché à ce professionnel d’avoir gardé le silence.
Mais l’absence de texte imposant une révélation ne doit pas conduire à minimiser le problème ou à fermer les yeux sur des comportements clairement dangereux pour les patients.
—
Certains des sociétaires qui ont interrogé la MACSF sur ce sujet ont fait état d’erreurs de leur confrère dans les prescriptions ou dans la réalisation d’actes techniques, d’absence de prise en charge cohérente ou encore de négligence dans la tenue du dossier médical.
La question d’une révélation de l’addiction doit donc nécessairement se poser, avec évidemment tout le tact qui s’impose. C’est en conscience que le professionnel devra s’interroger sur l’opportunité d’une telle démarche, qui peut paraître stigmatisante.
Une situation peu fréquente, mais pas rare
La MACSF est régulièrement interrogée sur ce sujet par ses sociétaires, dans le cadre de demandes de conseils au titre de leur contrat d’assurance en Protection juridique.
Le volume de demandes est modeste, comparé à d’autres thématiques plus récurrentes comme le domaine de compétences ou l’organisation des soins en établissement.
Mais cela reste révélateur d’un phénomène réel, illustré par quelques affaires aussi dramatiques que médiatiques.
—
Ce phénomène pourrait bien s’amplifier encore dans les années à venir, des études récentes mettant en évidence un fort taux de burn-out chez les professionnels de santé, et démontrant que 14 % d’entre eux seraient concernés par une conduite addictive (alcool et psychotropes/anxiolytiques).
L’activité médicale et paramédicale s’exerçant de plus en plus en équipe, la question de l’éventuelle responsabilité du collègue ou confrère qui "est au courant" de l’addiction et craint pour la sécurité de ses patients – et pour sa responsabilité ! – n’en a que plus d’importance.
Bien entendu, il conviendra, au préalable, de vérifier la réalité de l’addiction et de ses conséquences ; il serait hasardeux de se contenter de "on-dit" rapportés par des patients ou des confrères, sans les avoir soi-même constatés.
Ce type de révélation peut conduire à un examen de la situation du professionnel concerné par le Conseil de l’Ordre (par exemple, article R.4124-3 du Code de la santé publique pour les médecins).
Quelle responsabilité civile pour le professionnel de santé qui n’aurait pas dénoncé son confrère ?
La réponse va dépendre du statut sous lequel il exerce :
- En libéral : la responsabilité du professionnel demeure personnelle, pour les soins ou actes qu’il dispense. Chacun exerce en toute indépendance. En cas de litige, c’est donc avant tout à l’encontre du professionnel fautif qu’une action pourrait être dirigée. Il n’en demeure pas moins qu’en cas de collaboration, ce type de comportement peut nuire aux deux associés et rendre souhaitable une rupture du contrat de collaboration.
- En établissement de soins en tant que salarié : un professionnel de santé salarié ne peut engager sa responsabilité civile personnelle dès lors qu’il a agi dans le cadre des missions confiées par son employeur. Si, pour le professionnel qui souffre d’addiction, la question d’un exercice hors de ses missions peut se poser, tel n’est pas le cas pour le professionnel qui ne l’a pas dénoncé. Ainsi, dans ce cas, c’est l’employeur qui sera civilement responsable.
- En établissement de soins en tant qu’hospitalier : c’est à l’employeur de prendre en charge les indemnités allouées, et la victime devra mettre en cause la responsabilité administrative de l’établissement hospitalier pour une faute de service, devant le juge administratif. La seule hypothèse de mise en cause personnelle est celle de la faute détachable, peu probable dans cette situation.
Quelle responsabilité pénale pour le professionnel de santé qui n’aurait pas dénoncé son confrère?
La responsabilité pénale est personnelle. Si le comportement du collègue ou confrère est à l’origine d’une plainte pénale, c’est avant tout sa responsabilité - en tant qu’auteur direct du dommage - qui sera recherchée.
Mais la responsabilité de celui qui ne l’a pas dénoncé alors qu’il connaissait la situation peut également être recherchée, cette fois en tant qu’auteur indirect.
"Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer."
Article 121-3 alinéa 3 du Code pénal
Cette responsabilité en tant qu’auteur indirect n’est envisageable que si l’auteur a violé une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée. S’il n’existe pas à proprement parler de violation puisqu'aucun texte législatif n’impose d’effectuer un signalement en pareille hypothèse, il n’est pas possible de préjuger de l’appréciation d’un juge en cas de litige.
Sur le plan pénal, une non-assistance à personne en péril pourrait également être reprochée au professionnel qui s’abstiendrait de réagir.
Ainsi, dans une affaire médiatisée dans laquelle une femme est morte au cours de son accouchement du fait d’erreurs grossières commises par l’anesthésiste qui souffrait d’alcoolisme chronique, tant l’obstétricien de garde le soir des faits que le centre hospitalier (en tant que personne morale) ont été mis en examen pour ce motif.