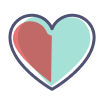Qu'est-ce que l'indemnité de fin de contrat ou de précarité ?
Il s'agit au départ d'une indemnité prévue spécifiquement par des dispositions du code du travail.
Un praticien contractuel exerçant dans un établissement hospitalier public, n'est a priori pas régi par les dispositions du code du travail (applicable aux salariés exerçant en établissements privés).
À ce titre, son statut figure dans le code de la santé publique (CSP).
Toutefois, la spécificité de ce statut repose sur le fait qu'il fait directement référence aux dispositions du code du travail pour réglementer certains points spécifiques.
Droit à l'indemnité de fin de contrat
Ainsi, l'article R. 6152-418 du CSP, énonce que :
"Les dispositions du code du travail et celles du code de la Sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L 351-12 du code du travail."
L'article L1243-8 du code du travail prévoit quant à lui que :
"Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant."
Quelles sont ses modalités de calcul ?
Base de calcul de l'indemnité
Compte tenu des dispositions précitées, on conçoit aisément que le montant d'une telle indemnité n'est pas négligeable, puisqu'elle est calculée sur la base de la rémunération totale brute effectivement perçue par le salarié, ce qui inclut bien sûr le traitement forfaitaire versé au praticien mais encore les astreintes, gardes, temps additionnel, et autres primes.
En outre, l'indemnité n'est pas uniquement calculée sur la rémunération versée au praticien contractuel au cours de son dernier contrat, mais bien sur la totalité de ses contrats : ainsi, s'il exerce depuis trois ans en qualité de praticien contractuel et que son dernier contrat n'est pas renouvelé, l'indemnité devra alors être calculée sur la base des rémunérations brutes perçues pendant ces trois années.
Obligation de versement et implications fiscales
Dans ces conditions, on comprend que certains employeurs - certes de moins en moins nombreux - "omettent" encore de verser cette indemnité de fin de contrat.
A fortiori, il s'agit d'un complément de salaire et non de dommages et intérêts : cette somme est donc soumise à cotisations, et reste assujettie à l'impôt sur le revenu.
Modalités de versement
Elle doit être versée à l'issue du contrat de praticien contractuel en même temps que le dernier salaire et doit donc figurer sur le bulletin de paie correspondant.
Délai de réclamation pour non-versement
Si elle n'est pas réglée spontanément par l'employeur, le praticien dispose d'un délai de quatre ans (prescription quadriennale) pour en réclamer le paiement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction du centre hospitalier. Ce délai de quatre années court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Dans quels cas cette indemnité n'est-elle pas due ?
Pour répondre à cette question, il convient là encore de se reporter aux dispositions du Code du travail et en particulier à l'article L1243-10.
Ainsi, l'on notera que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
- Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
- En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Ainsi, si le praticien contractuel démissionne de ses fonctions avant l'échéance du terme ou est licencié pour faute grave, il ne percevra pas l'indemnité de fin de contrat.
- De même, si l'employeur vient à proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) au praticien, à des conditions d'emploi identiques à celles de son dernier CDD et que le praticien contractuel refuse la proposition, il ne pourra alors plus prétendre à bénéficier de l'indemnité de précarité.
Le statut de praticien contractuel a ceci de spécifique que tous ceux qui sont recrutés en CDD ne se verront pas nécessairement proposer un CDI. Cette possibilité de conclure un CDI est relativement récente et a été mise en place par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010.
Conditions d'attribution de l'indemnité
Ainsi, l'article R. 6152-403 du CSP énonce que :
"Les praticiens contractuels peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée".
Critères spécifiques pour un CDI
On note là que seuls sont susceptibles d'être concernés par un CDI, les praticiens contractuels recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres – et encore faut-il qu'ils aient préalablement accompli six années en CDD en qualité de praticien contractuel avant d'espérer se voir proposer un CDI.
En réalité, la plupart des praticiens se verront proposer des CDD qui ne pourront dépasser une durée totale d'engagement d'un an, voire deux ans ou encore trois ans, conformément à leur statut et aux dispositions de l'article R. 6152-402 du CSP.
Durées maximales des contrats
Ainsi, en cas de recrutement en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé, la durée d'engagement ne peut excéder 6 mois par période de 12 mois.
Remplacement des praticiens hospitaliers
Dans l'hypothèse d'un recrutement, pour assurer en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts, le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'1 an.
Recrutement pour postes vacants
De même, si le praticien contractuel est recruté pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
Il en ira de même s'il est recruté pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées.
Quelles sont les conséquences du refus de postuler à un poste vacant pour un praticien hospitalier ?
Par un arrêt rendu le 22 février 2018 (n° 409251), le Conseil d’État a opéré un important revirement de jurisprudence et jugé que lorsqu’un l’établissement hospitalier employant un praticien contractuel, déclare vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de sa spécialité, le refus de ce dernier de présenter sa candidature pour cet emploi, alors qu’il a été admis au concours national de praticien des établissements publics de santé, est assimilable au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée, au sens de l’article L1243-10 du code du travail.
Pour le Conseil d’État, ce refus prive donc le praticien contractuel du bénéfice de l’indemnité de précarité. Ce faisant, le Conseil d’État revient sur la jurisprudence amorcée par le tribunal administratif d’Orléans le 27 mars 2012 (décision n° 1001807).
Pour mémoire, le tribunal administratif d'Orléans, avait jugé au contraire que le poste de praticien hospitalier ne pouvait être assimilé à un CDI car d'une part, il supposait de passer un concours au niveau national, d'autre part un praticien hospitalier n'est pas dans une position contractuelle mais réglementaire et enfin il ne présentait aucune garantie de recrutement pour le médecin qui postulait : c'est en effet non pas le directeur du centre hospitalier qui contracte mais le centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui nomme, sur proposition du directeur de l’établissement hospitalier et sur avis du président de la commission médicale d’établissement.
La Cour administrative d'appel de Marseille a statué dans le même sens dans une affaire similaire le 1er octobre 2020 (Cour administrative d'appel Marseille APHM 01/10/2020 - Requête n° 19MA02571).
Dans cette affaire, la Cour administrative d'appel a en outre souligné que les postes vacants, sur lesquels le praticien n'avait pas souhaité postuler, relevaient non seulement de sa spécialité, mais encore que la rémunération proposée pour ces postes était au moins équivalente. à celle qu'il percevait.
L’indemnité reste-t-elle due si le praticien refuse le renouvellement de son contrat ?
Comme nous l’avons vu plus haut, lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L1243-10 du Code du travail.
La Cour administrative d’appel de Nantes en a logiquement déduit qu’un praticien contractuel informant sa direction qu’il ne souhaite pas accepter le renouvellement de contrat de travail à durée déterminée qui lui est proposé, ne peut être regardé comme ayant rompu, au sens du 4° de l’article L1243-10 du code du travail, de manière anticipée son dernier contrat qui a été exécuté jusqu’à son terme.
En pareille circonstance, l’indemnité doit donc lui être versée. (CAA de Nantes, 3e chambre, 23 avril 2021, 19NT03264, Inédit au recueil Lebon).
Les contrats de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ouvrent-ils le droit à l'indemnité de précarité ?
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2020, le Conseil d'État a jugé que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge.
Pour le Conseil d’État, c’est la nature même de ces contrats qui ne permet pas au praticien de prétendre à une indemnité de précarité.
Le Conseil d’État souligne ainsi que, "de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 1er et 3 du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005, insusceptibles de se poursuivre par un CDI" (Conseil d'État 28 septembre 2020, n° 423986).
Quelles sont les règles et conséquences de la réforme du statut de praticien contractuel sur l'indemnité de précarité ?
Le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels régis par les articles R6152-334 à R6152-394 du code de la santé publique a été publié le 7 février 2022.
Ces nouvelles règles se substituent aux trois statuts suivants : praticien contractuel (articles R6152-401 à R6152-436 du CSP), praticien attaché (articles R6152-601 à R6152-637 du CSP) et praticien recruté sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (les "cliniciens", articles R6152-701 à R6152-720 du CSP).
À compter de l’entrée en vigueur de ce décret, soit le 7 février 2022, aucun nouveau contrat de praticien contractuel (au titre des articles R6152-401 et suivants du CSP) ne peut être conclu.
Les praticiens sous contrat relevant désormais de l’ancien statut des praticiens contractuels, praticiens attachés ou cliniciens à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 précité, soit au 7 février 2022, resteront régis par les dispositions de leur statut et de leur contrat jusqu'au terme de celui-ci.
Indemnité de précarité pour les nouveaux praticiens
Pour ce qui est des "nouveaux" praticiens contractuels, l’indemnité de précarité est visée par l’article R6152-375 du code de la santé publique.
Il est prévu par cet article que, lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L1243-10 du code du travail, c’est-à-dire lorsque le praticien refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, ou en cas de rupture anticipée du contrat due à son initiative, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Exceptions à l'indemnité
L’indemnité de précarité n’est pas non plus due dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R6152-308 du code de la santé publique (c’est-à-dire la liste d’aptitude sur laquelle sont inscrits les lauréats du concours de praticien hospitalier), ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
Montant et versement de l'indemnité
L’arrêté d’application du 5 février 2022 précise que le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article R6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours.
Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC.
Conditions spécifiques pour l'attribution
En outre, dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d'émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l'annexe XX de l'arrêté du 15 juin 2016, cette indemnité n'est pas attribuée ; ce seuil minimum s’élève à 39 396 euros au 1er février 2022.
Enfin il est spécifié que cette indemnité est versée en une fois au plus tard un mois après le terme du contrat.