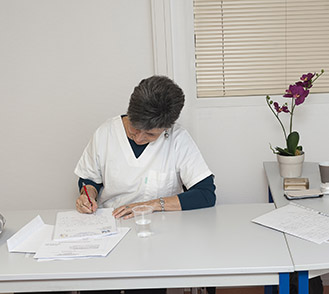Le cadre règlementaire
Le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 sur les actes professionnels et l’exercice de la profession d’infirmier, modifié par un décret du 29 juillet 2004, codifié au Code de la santé publique (CSP) aux articles R.4311-1 et suivants est parfaitement clair.
L’article R.4311-7 précise que :
"L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : (…)".
Aucun acte de soins, ne relevant pas de son rôle propre, ne peut être réalisé par un infirmier diplômé d'Etat (IDE) sans une prescription écrite du praticien.
En cas de délivrance d’une prescription orale hors situation d’urgence, la responsabilité de concert, du médecin et de l’infirmier sont susceptibles d’être engagées sur trois terrains : disciplinaire, civil et pénal (par exemple pour mise en danger de la vie d’autrui).
L'urgence, la seule exception au principe de prescription écrite
Une seule exception est prévue par le cadre juridique : la prise en charge d’un patient dans le contexte très particulier de l’urgence.
Quelle définition donner à la notion d'urgence ?
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) tente de répondre à cette difficile question dans son bulletin de juillet 2018 :
"Dans la tradition française, l’urgence se définit par la mise en danger à brève échéance – l’heure ou la demi-journée – de l’intégrité physique, voire de la vie de la personne…"
Cette notion d’urgence est donc difficile à cerner et est souvent laissée à l’appréciation des professionnels de santé et des juges du fond…
Cette base étant posée, il serait faux de penser que l’urgence vaut dispense de prescription ! Il appartient au médecin de régulariser par écrit cette dernière le plus rapidement possible en la faisant figurer dans le dossier du patient.
Quant au personnel infirmier confronté à cette situation, il se doit d’établir un compte rendu détaillé retraçant les événements, les instructions délivrées par le médecin s’il est à distance ou non et les actes de soins dispensés.
En effet, il convient de rappeler l’importance fondamentale de l’écrit en cas de litige, seul élément de preuve pouvant jouer en faveur d’une exonération de la responsabilité.
Enfin, il est important de rappeler que tout protocole thérapeutique rédigé dans le respect du cadre réglementaire doit suffire pour dispenser des actes de soins dans le contexte d’un patient ayant un état de santé modifié.
Dans certains contextes d’urgence, la rédaction d’un protocole thérapeutique de soins permet à l’infirmier d’accomplir des actes conservatoires jusqu’à l’intervention du médecin (article R.4312-29 du CSP).
L’infirmier doit veiller à assurer une traçabilité précise de ses actes dans ces circonstances particulières.
La prescription écrite : un élément de la sécurité des soins
Au-delà du cadre réglementaire, une prescription écrite permet de vérifier plusieurs points incontournables et de générer de fait un cadre favorable aux bonnes pratiques :
- Identifier le patient.
- Vérifier la dénomination du médicament ou de l’examen prescrit.
- Contrôler avec précision le dosage du médicament ou des précautions à prendre pour l’examen ou le soin.
- S’assurer de sa planification horaire.
- Valider la voie d’administration dans le cas d’une substance médicamenteuse.
La prescription orale, formulée très souvent par un praticien pressé, qui plus est peu sensible aux interruptions de tâches générées, constitue de fait des zones de vulnérabilité pour le soigné et pour le soignant (rappelons qu’une erreur générant de lourdes conséquences pour le malade aura des impacts pour le professionnel de santé comme seconde victime).
La prescription écrite présente donc l’avantage :
- de pouvoir respecter de manière exhaustive les recommandations de bonnes pratiques en termes de sécurité pour les soignants réalisant l’acte ;
- d’être invariante ;
- d’être analysée par d’autres professionnels, notamment lors de la validation faite par le pharmacien.
Infirmier(e), quelles solutions pour éviter l'évitable ?
L’IDE se sent souvent seul face à cette problématique : faire ou ne pas faire le soin préconisé ? Un choix difficile... :
- Se mettre en danger en réalisant l’acte de soins (avec des vulnérabilités importantes) car on craint pour le pronostic du patient ?
- Mettre le patient en danger si on ne réalise pas le soin préconisé ?
Il n’est pas admissible qu’un paramédical se trouve face à un tel dilemme
Aussi, certains établissements de santé et la communauté médicale se sont mobilisés pour fixer des règles de fonctionnement précises en votant en Commission Médicale d’Etablissement une motion applicable systématiquement :
Pas de prescription, pas de soin dispensé !
—
Cette position, défendue par la majorité des prescripteurs, permet aux paramédicaux de se positionner et prendre appui sur cette résolution. Le retour d’expérience constaté de cette stratégie est très positif dans les structures de soins qui l’ont mise en œuvre.
Enfin, avec le déploiement du Dossier Patient Informatisé (DPI), et la possibilité donnée aux prescripteurs de se connecter à distance (au sein de l’établissement de santé ou de son domicile) par voie électronique, la prescription orale n’est plus justifiable.