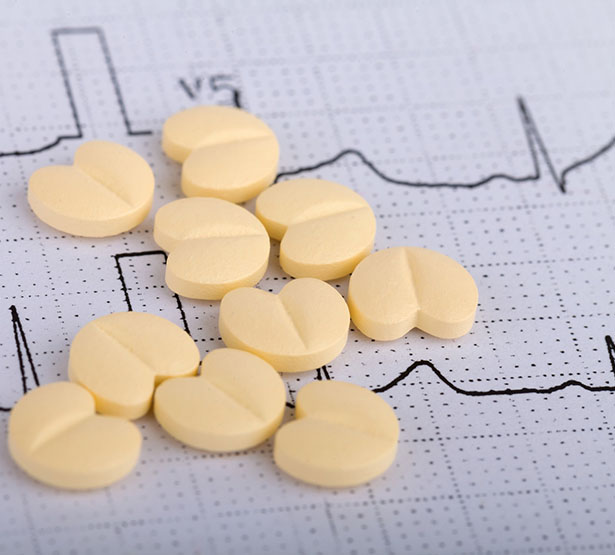Les risques inhérents aux anticoagulants classiques
Dans la prévention des accidents thromboemboliques artériels ou veineux, les indications des anticoagulants ont été élargies par les sociétés européennes et nord-américaines de cardiologie, en particulier chez les sujets âgés, réticents à les utiliser.
Cet élargissement s’est traduit par un doublement des ventes d’anticoagulants entre 2002 et 2012. En 2013, près de trois millions de patients ont ainsi reçu au moins un anticoagulant(1).
Quelle que soit la nature du traitement anticoagulant, les risques inhérents à l’utilisation de ces molécules sont :
- les hémorragies (par surdosage ou méconnaissance d’une pathologie sous-jacente susceptible de saigner) ;
- les accidents thromboemboliques (en cas de dose insuffisante ou d’interruption prolongée de traitement).
Ces accidents font l’objet de nombreuses plaintes contre les médecins (Panorama des risques professionnels en santé(2)). En 2013, sur 85 déclarations de sinistres adressées par des cardiologues, six concernaient des accidents liés à la prise d’anticoagulants. Trois accidents similaires ont été répertoriés chez les anesthésistes, et quatre chez les médecins généralistes.
Par ailleurs, 13 % des hospitalisations secondaires consécutives à des effets indésirables médicamenteux sont liées à une hémorragie sous AVK (17 000 hospitalisations, dont plus de la moitié serait évitable, selon une étude conduite en 1998 par les centres de pharmacovigilance)(1).
Face à l’importante variabilité individuelle de la réponse au traitement par AVK et au difficile dosage à effectuer pour obtenir un INR (International Normalized Ratio) à l’équilibre, plusieurs Anticoagulants Oraux Directs (AOD) ont été développés et mis sur le marché à partir de 2009.
Jusqu’en 2012, peu de plaintes en rapport avec ces nouvelles molécules ont été rapportées. C’est en 2013, moment de basculement important vers ces nouveaux traitements, qu’apparaissent les premiers accidents liés à l’usage de ces AOD, qui représentent alors 30 % des anticoagulants oraux, contre 70 % pour les AVK(1).
Les études multicentriques internationales ont globalement démontré que les AOD permettaient d’accroître l’efficacité contre les accidents thromboemboliques sans pour autant augmenter le risque d’hémorragie, voire en le diminuant.
Cela étant, ces études ont été réalisées dans un cadre très contrôlé avec des médecins ayant une parfaite connaissance de ces molécules.
C’est essentiellement la méconnaissance des nouvelles règles de prescription qui induira les premiers accidents liés aux AOD.
Les accidents liés aux anticoagulants oraux
Gestion des INR
Avant l’apparition des AOD, le problème le plus fréquemment rencontré concernait la gestion des résultats d’INR.
Une certaine confusion est souvent constatée pour savoir qui gère le traitement, du médecin généraliste, du cardiologue ou des autres praticiens intervenant à titre occasionnel (anesthésiste, chirurgien).
De par son statut de "médecin traitant" et sa plus grande disponibilité, le médecin généraliste est souvent désigné comme l’interlocuteur privilégié.
La prévention des accidents repose avant tout sur l’éducation du patient et la tenue de son carnet de résultats
Il est important de conseiller une parfaite traçabilité des modifications de doses et des résultats d’INR sur ce carnet. À défaut, il est difficile de pouvoir ajuster les doses sans connaître la réactivité biologique du patient à ce traitement.
Lorsque les doses sont modifiées à l’occasion d’une consultation, il est important d’assurer la traçabilité sur ordonnance des rythmes de contrôle de l’INR, surtout dans le cas d’une modification substantielle consécutive à un surdosage ou un sous-dosage.
Dans une procédure civile, un généraliste avait, à la suite d’un surdosage, prescrit une diminution de dose et conseillé verbalement un contrôle de l’INR quelques jours après. Mais la patiente n’effectuera pas ce contrôle et présentera une hémorragie fatale. Le défaut de production d’une ordonnance ou d’une mention dans son dossier médical a entraîné la condamnation du généraliste.
Pour prévenir ce risque d’errance des patients, il convient également de les inviter à reprendre contact avec leur médecin après avoir récupéré leurs résultats.
Anticoagulants et périodes péri-opératoire
Les règles de prescription en la matière ont profondément changé.
À l’occasion d’une chirurgie parfois hautement hémorragique, il n’est pas inutile de s’interroger sur le bienfondé de l’indication des anticoagulants. En effet, ces traitements ont parfois été prescrits sur une indication temporaire, sans remise en cause ultérieure, et ont pu être renouvelés de manière automatique.
Par ailleurs, il faut savoir qu’un certain nombre de gestes chirurgicaux n’imposent plus comme auparavant un arrêt impératif des anticoagulants, surtout s’il existe une indication robuste aux anticoagulants (prothèse de valve, fibrillation auriculaire….).
Si la chirurgie, de par les risques d’hémorragie qu’elle comporte, impose un arrêt des anticoagulants, le médecin traitant, comme les anesthésistes et les chirurgiens, doivent s’accorder avec le cardiologue sur la nécessité ou non d’une substitution par une héparine ou un anticoagulant de courte durée.
Une stratégie péri-opératoire claire doit être définie de façon collégiale
- Arrêt ou non des anticoagulants ?
- Combien de temps avant la chirurgie ?
- Substitution ou non ?
- Par quelle molécule ?
- Date de la reprise avec héparine en attendant un INR efficace.
Autres circonstances de déstabilisation du traitement anticoagulant
- Chez des sujets âgés, la survenue d’une insuffisance rénale ou d’un trouble métabolique peut perturber l’anticoagulation.
- La survenue d’une infection, la prescription d’une antibiothérapie ou encore des troubles du transit, peuvent déséquilibrer le traitement anticoagulant.
- L’apparition de troubles mnésiques peut également compromettre la fiabilité de la gestion des anticoagulants.
- Enfin, les pertes d’autonomie et le risque de chutes peuvent rendre de plus en plus délicate la poursuite des anticoagulants classiques.
Les précautions requises dans l’usage des AOD
Il est indiscutable que l’absence de nécessité d’un suivi en lien avec l’INR a grandement favorisé la diffusion des AOD.
Cette apparente simplicité a peut-être fait oublier aux prescripteurs que ces molécules avaient une pharmacologie différente des AVK.
—
C’est d’ailleurs ce que l’Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) a rappelé lors d’un communiqué de septembre 2013, en précisant que tous les prescripteurs ne sont pas suffisamment informés de la prise en charge des risques hémorragiques telle que recommandée dans les résumés des caractéristiques du produits (RCP)(3).
Précédemment, l’ANSM avait établi un rapport complet sur les anticoagulants, synthétisant les données disponibles sur le sujet : "Les anticoagulants en France en 2012 – Etat des lieux et surveillance – Rapport thématique (ANSM, Juillet 2012)(1)"
La première des précautions consiste à se souvenir que ces molécules n’ont pas toutes les mêmes indications que les AVK et n’offrent pas toutes, selon la Haute Autorité de Santé (HAS), un bénéfice équivalent. La HAS recommande que les AVK soient prescrits en première intention et que les AOD soient réservés aux patients dont le contrôle des INR est difficile ou qui refusent le contrôle biologique de l’INR(4).
Un dossier a fait l’objet d’une procédure en 2013, dans lequel un médecin généraliste avait remplacé les AVK par un AOD chez un patient porteur d’une valve mécanique mitrale en fibrillation auriculaire, ce qui constitue une contre-indication formelle à ces molécules. Moins de quinze jours plus tard, le patient a présenté une thrombose de valve ayant nécessité une intervention en urgence pour remplacer celle-ci. Cette réintervention s’est compliquée d’une septicémie heureusement jugulée.
Dans plusieurs dossiers, c’est la non prise en considération de la fonction rénale qui est à l’origine de complications hémorragiques. Selon les molécules (essentiellement le Pradaxa® dabigatran etexilate), il est nécessaire de diminuer la dose ou de ne pas utiliser ces molécules selon la clairance de la créatininémie.
Dans un autre dossier, le patient avait initialement une fonction rénale au-dessus de la valeur seuil autorisée. Puis, lors d’une poussée d’insuffisance cardiaque traitée par des diurétiques et d’un épisode infectieux, la fonction rénale s’est dégradée et le patient a présenté une hémorragie cérébrale. Face à ce patient âgé, avec une fonction rénale limite et le risque connu de dégradation (insuffisance cardiaque, diurétique...), il a été reproché au généraliste de ne pas avoir contrôlé la fonction rénale pour adapter la dose d’AOD.
Dans un dossier de gestion péri-opératoire d’un patient prenant des AOD, il n’avait pas été intégré que ces molécules pouvaient avoir une demi-vie variable en fonction de la clairance de la créatinine. Ainsi, lors d’une chirurgie d’hernie inguinale, un traitement par AOD avait été interrompu 24 heures avant l’intervention, alors que le laboratoire préconisait trois jours dans ce cas de figure. Le patient a été victime d’une hémorragie péri-opératoire fatale.
Dans plusieurs dossiers, c’est la méconnaissance du nom des nouvelles molécules anticoagulantes par les urgentistes qui est à l’origine de la gravité des accidents. De ce fait, le traitement par AOD a été poursuivi alors que des patients avaient été admis dans des services d’urgence soit pour des hémorragies, soit pour d’autres motifs médicaux, qui imposaient l’arrêt du traitement.
Si les AOD ont apporté un bénéfice thérapeutique certain, il n’en reste pas moins que face à des hémorragies ou des situations nécessitant une chirurgie urgente, il est préférable d’adresser ces patients vers des centres experts (ou au minimum de prendre conseil).
Même si aucun antidote n’a encore été commercialisé, il existe un nombre important de mesures thérapeutiques permettant d’enrayer l’hémorragie et les complications inhérentes.
L’élargissement des indications des AOD à des populations plus fragiles impose davantage de précautions et une parfaite coordination entre les professionnels de santé.
—
Sans mettre en cause le bénéfice de ces nouveaux traitements, il est impératif d’intégrer que ces molécules ont des indications différentes des AVK et qu’elles se manient différemment (importance de la fonction rénale, demi-vie variable, interactions médicamenteuses différentes par rapport aux AVK).
Il faut remarquer par ailleurs le coût très supérieur du traitement par AOD à celui par AVK, non compensé par la réduction du coût de suivi des patients sous AOD (INR et consultations médicales d’adaptation de la posologie).
Au vu de ces éléments, la HAS demande que les AVK demeurent les anticoagulants prescrits en première intention, même si cela peut parfois aller à l’encontre de certaines recommandations de sociétés savantes européennes ou nord-américaines.